Abonnés Hebdo Articles
23.11.2025 à 11:26
Les minuscules récipients crochetés de Jeremy Brooks défient les limites de l'argile
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1696 mots)
Au premier coup d'œil, on pourrait croire que les récipients crochetés de Jeremy Brooks sont noués avec du cordon en vinyle. Ces pièces ludiques, colorées et méticuleusement travaillées sont en réalité en porcelaine.

“Knot Pot 2503” (2025), crocheted colored porcelain, 2.75 x 3 x 3.25 inches
Ses œuvres sont également d'une taille trompeusement petite, généralement environ 7,5 cm de large, ce qui rend le processus de couture littérale de minces morceaux d'argile encore plus impressionnant.
Actuellement basé à Conway, en Caroline du Sud, où il est professeur associé d'arts visuels (céramique) à la Coastal Carolina University, Brooks a passé ces dernières années à expérimenter la consistance de l'argile. Alors que nous pouvons considérer ce matériau durci comme fragile et rigide, l'artiste repousse les limites de sa flexibilité.




« Une partie de mes recherches s'est concentrée sur un mélange unique de matériaux argileux qui possèdent des qualités d'élasticité plutôt que les qualités de plasticité que l'on trouve traditionnellement dans les recettes d'argile courantes », explique-t-il dans un communiqué. « Pour parler clairement, ce matériau se comporte davantage comme du caoutchouc que comme de l'argile, et il durcit très rapidement une fois que les composants ont été mesurés et mélangés. »
Brooks commence par extruder de longs rouleaux de différentes couleurs, qu'il roule parfois en plaques fines comme du papier. Contrairement à la terre crue (argile durcie mais non cuite), ce matériau est très souple et extensible. « Un rouleau fabriqué à partir de cette argile peut facilement être noué », explique-t-il. « Cette méthode peut être utilisée pour assembler différentes pièces, ou l'argile peut être crochetée, tricotée ou tissée pour créer des formes plus dynamiques. »

“Wood Fired Knot Pot 11” (2025), crocheted wood-fired stoneware, 2.75 x 3 x 3.25 inches
De nombreux récipients de Brooks sont des expressions exubérantes de couleur, tandis que d'autres sont plus terreux et cuits au bois. Comme s'ils étaient faits d'un matériau souple, les récipients semblent s'écraser et se plier, soulignant encore davantage la référence vibrante à la fibre.
Les œuvres de Brooks sont exposées aux côtés de celles de Steven Young Lee et Michael Velliquette jusqu'au 31 décembre à la Duane Reed Gallery de Saint-Louis. Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.
Kate Mothes, le 25/11/2025
Les récipients crochetés de Jeremy Brooks

23.11.2025 à 10:18
Les 70's aventureuses d'Aksak Maboul avant Aksak Maboul
L'Autre Quotidien

Texte intégral (875 mots)
Assemblée à partir de bandes magnétiques et de cassettes longtemps oubliées, cette collection explore la préhistoire d’Aksak Maboul en dévoilant certains des tours et détours qui ont conduit à la création du légendaire projet de pop expérimentale, fondé en 1977, toujours actif en 2025.
Découvrir les prémisses de ce groupe matrice de nombreux autres projets apporte un autre et nouvel éclairage sur ce que le label Crammed Disc allait développer, dès le début des années 80, avec les punks Tueurs de la lune de miel, puis le catalogue des labels affiliés à registre bizarre et décalé : de la new wave avant-gardiste de Tuxedomoon et Minimal Compact 80’s au suivi synchro de la techno 90’s, en passant par la musique africaine et toutes sortes de bizarreries que personne n’aurait signé.
Donc, envoi de ce roman d’apprentissage qui débute en 1969 lorsque, âgés respectivement de 19 et 20 ans, Marc Hollander et le guitariste italien Paolo Radoni montent un groupe pour jouer une mixture étrange de rock et de free jazz. Baptisée Here and Now (sans rapport avec le groupe britannique qui adoptera le même nom quelques années plus tard), la formation se transforme rapidement en un tentet détonnant qui remporte un concours, se retrouve impliqué dans le tourbillon autour du mythique festival d’Amougies, et décroche un contrat avec le label français qui monte, BYG Records (mais finit toutefois par ne rien enregistrer).
D’autres musiciens rejoignent le collectif (dont Vincent Kenis et Denis Van Hecke, futurs membres d’Aksak Maboul), qui se dissout en 1972. Marc Hollander se lance alors dans une série d’enregistrement solo et de collaborations (1973-1977), au cours desquelles seront explorées certaines des directions qui formeront la trame d’Aksak Maboul.
C’est peu dire le terrain déblayé par ce groupe/collectif explosé d’artistes qui suivent l’évolution du son, pour pouvoir ensuite, une fois le projet au point, développer autre chose et innover à partir de canevas connus pour mieux les détourner à leur profit avec un goût certain et un succès en dents de scie dans un monde assujetti à la variète et aux taupes 50. Et à bien étudier le son , on y retrouve aussi bien le côté zappien du projet, les emprunts à Soft Machine, à Can, Eno et au free européen. Au fil de dix-sept titres et 80 minutes de musique irriguée par les fertiles bouleversements de l’époque, nous traversons des moments de free rock et d’improv, de quasi-kraut, d’électronique modulaire ou ambient, des pièces de piano ou de percussion, des expérimentations diverses, qui laissaient présager ce qu’Aksak Maboul allait (ou aurait pu) devenir par la suite… Mais la suite, on vous a déjà parlé. Donc, pour le point de vue immanquable sur les 70’s méconnues, ce petit retour en arrière, aux sources et au son, vous sera un précieux viatique. Zyva, on l’achète sans faillir.
Jean-Pierre Simard le 25/11/2025
Aksak Maboul - Before Aksak Maboul - Crammed Disc

22.11.2025 à 20:04
Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4793 mots)
Ce week-end, du 21 au 23 novembre 2025 vous aviez rendez-vous à BD Colomiers, un festival en région Occitanie qui fête ses 40 ans ! Pour parler de ces 40 ans, de la ligne éditoriale, des affiches ou encore de la programmation, je vous propose une rencontre avec Amandine Doche.

Photo d’Amandine Doche / Crédits photo ©DR
Responsable du service culturel à la mairie de Colomiers et directrice artistique du festival BD Colomiers dont elle assure la programmation avec François Poudevigne, Amandine Doche développe ce festival depuis 15 ans et a imprimé une patte singulière qui en fait l’un des incontournables chaque année.
Au programme de cette édition 2025, des expositions consacrées au travail de Delphine Panique, Laurie Agusti, Aniss el Hamouri, Camille Potte, Hugues Micol & Eva Offredo ; des rencontres avec Nick Drnaso, Tom Gauld, Fanny Michaëlis, Michael DeForge, Anders Nilsen, et Lisa Hanawalt ; des concerts dessinés, des ateliers, des projections et des fresques dans la ville. Tout le programme est dispo ici.
Mais découvrons les coulisses avec sa directrice artistique.
Tu travailles au service développement culturel de la Mairie de Colomiers et tu es en charge du festival, et d’autres événements j’imagine, est-ce que tu peux expliquer quelle est la place de la bande dessinée dans ton travail ?
Amandine Doche : C’est la plus grande part de mon travail. Je suis arrivée ici grâce à la bande dessinée, pour m’occuper du festival BD. On n‘y travaille pas à 100% du temps toute l’année, mais on y travaille un peu toute l’année.
L’autre moitié du temps est consacrée aux autres événements culturels de la ville —je coordonne ce service— et ce qu’on propose est toujours autour de l’illustration ou de l’image animée en général. On a essayé de bâtir une saison à Colomiers autour du dessin et de la bande dessinée au sens large.
Mais la BD c’est ce que je préfère. C’est ma formation, c’est ce que j’aime travailler.
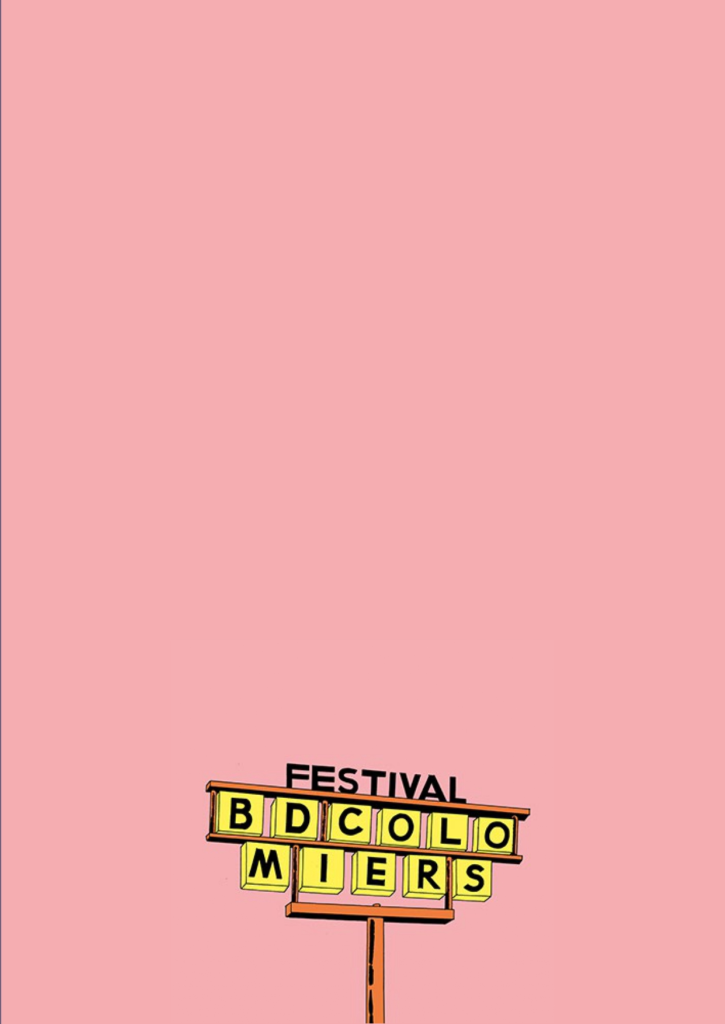
Affiche d’Anna Haifisch pour BD Colomiers 2025 ©Anna Haifisch
Le festival à 40 ans cette année, toi tu y travailles depuis 15 ans, comment tu as vu l’évolution ?
A.D. : Je le connaissais assez peu avant, je le connais de ce qu’on m’a raconté ou de ce que j’en ai vu des quelques éditions auxquelles j’avais participé. Ce festival avait eu un grand succès, mais il y a 15 ans, il était un peu en perte de vitesse et il n’y avait pas de ligne artistique très dessinée.
Et c’est ce qu’on a essayé d’opérer comme virage quand je suis arrivée : de donner une ligne artistique forte en s’orientant vers l’édition indépendante et la jeune création pour se différencier un peu des très gros festivals de bande dessinée —qu’on ne pouvait pas concurrencer en termes de place, d’accueil, de volume— tout en laissant la place à cette bande dessinée qui nous semblait hyper importante à défendre en festival.
Le festival s’adresse à un public d’amateurices éclairés, de lecteurices curieux, mais aussi aux familles, comment vous affinez vos propositions en fonction de la fréquentation & différents publics ?
A.D. : C’est un peu le jeu de l’équilibriste qu’on fait tous les ans, on essaye de faire des propositions assez exigeantes : que ce soit les expos, les rencontres, les projections… mais toujours en proposant des médiations ou des choses à côté qui soient plus ludiques ou plus familiales pour que les festivaliers non spécialistes se sentent invités.
Cette année, par exemple, il y a une expo de Laurie Agusti et dans son album Rouge Signal, il y a une partie de l’histoire qui se passe dans un salon de nail art, eh bien on a recréé un vrai salon de nail art à la sortie de l’exposition où les gens pourront venir se faire dessiner sur les ongles, avec la palette chromatique utilisée dans la bande dessinée. C’est une façon de plonger dans l’univers du livre, de découvrir le dessin sous une autre forme et d’avoir un aspect plus ludique, plus joyeux ; mais en lien avec la proposition de base.
Et on essaye de penser toutes nos expos, toutes nos propositions comme ça, pour que les non spécialistes se sentent vraiment invités. C’est ce que je préfère, et je trouve que c’est hyper important de ne pas en faire un festival de spécialistes et en même temps de tenir cette ligne assez pointue.
Il y a une soixantaine d’éditeurs présents, et ils nous disent que le public de Colomiers est curieux, qu’il pose plein de questions sur les stands et qu’ils achètent des livres pas forcément les plus attendus. Maintenant, les festivaliers savent qu’ils ne vont pas trouver la grosse artillerie mainstream, et ils sont curieux de voir ce qui sera proposé. Ça, c’est assez chouette.
C’est, j’imagine, le travail qu’il s’est imaginé dessiné au fil des ans, avec les anciens, les nouveaux et j’ai l’impression que le public à progressé avec le festival [rires].
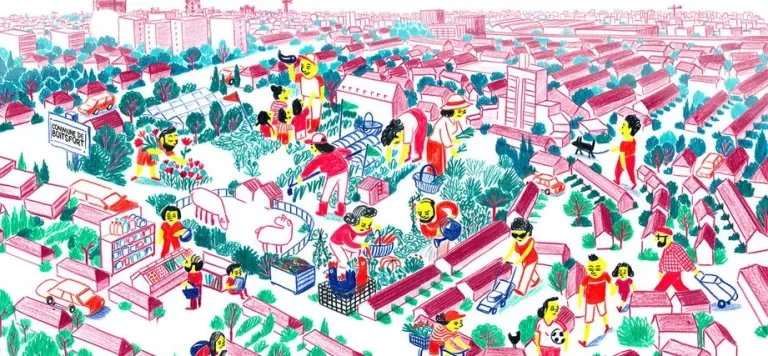
Illustration de Lucie Castel / ©Lucie Castel
Et le public, vous savez si c’est surtout des gens du coin et s’il y a des gens qui viennent de toute la France ?
A.D. : Oui il y a pas mal de Columérins & Columérines pour le public familial, mais la majorité viennent de la métropole toulousaine, Toulouse et les communes alentours : surtout les publics d’étudiant.e.s et jeunes d’adultes.
Et pour ceux qui viennent de plus loin, ça va représenter 10% du public, c’est minoritaire, mais il y en a de plus en plus. L’année dernière, on a mis en avant l’éditeur canadien Drawn & Quarterly, ça attire aussi des collectionneurs. Sortir des frontières de la métropole, c’est un peu plus long et lent, mais ça arrive petit à petit.
Le programme est riche, entre les expos, rencontres, projections, comment vous concevez la programmation ? Est-ce qu’il y a à chaque fois un fil rouge ? Un cahier des charges ?
A.D. : Ça dépend des années. Depuis 2 ans, on est deux pour la programmation, avec François Poudevigne, et on essaye de voir ce qui se dessine comme tendance dans la bande dessinée, de voir les sujets qui pourraient nous sembler pertinents ; soit en lien avec l’actualité, soit en lien avec les évolutions sociétales. Et on essaye de dessiner comme un fil rouge, mais on ne s’impose pas de thématique ou de cadre où il faudrait absolument rentrer toutes les propositions dedans.
Cette année, par exemple, on a travaillé sur deux axes : sur la question du genre dans les récits de genre et sur la question du genre dans la littérature jeunesse.
Et un autre volet qui est plus ludique : comme c’est les 40 ans, on a essayé de faire des propositions plus funs, qui peuvent plaire au plus grand nombre. Comme le grand jeu All You Need is Lire, un jeu d’énigme dans toute la ville pour gagner 1 an de BD. Mais ça reste exigeant, c’est Jérôme Dubois qui nous l’a conçu et même nous les énigmes on les a trouvées compliquées [rires], mais il a fait ça, super bien ! Il a créé des personnages incroyables, ça va vraiment être drôle.
Voilà, c’était nos fils conducteurs de l’année et on essaye tous les ans de s’en donner de nouveaux, mais après, c’est beaucoup de coups de cœur sur des livres dont on ne veut pas passer à côté. Par exemple Drawn & Quarterly, c’était un de mes objectifs de vie ; et l’année prochaine, on sait qu’on va faire une exposition sur Tove Jansson avec ses bandes dessinées, mais aussi ses travaux d’écriture et de peinture. Et on va pouvoir accoler toute la nouvelle génération d’autrices qui se sont un peu inspirées de son travail, et on va pouvoir commencer à dessiner une programmation autour de cette première idée.
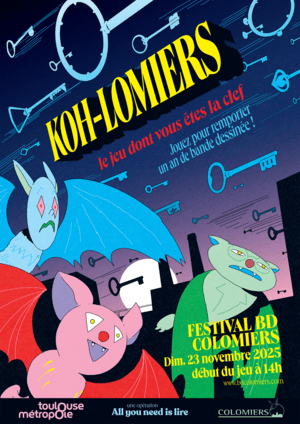
Affiche de Jérôme Dubois pour sa chasse aux trésors
Et en parlant d’artistes internationaux, il y a aussi le cartonnist Tom Gauld ou Lisa Hanawalt la co-créatrice de la série animée Bojack Horseman, ce sont des rencontres qui se préparent sur plusieurs années ?
A.D. : Lisa on a mis un peu de temps, c’est vrai, mais en général c’est quelques mois de travail pour mettre ça en place. Et c’est quelque chose qui était impossible pour nous il y a encore quelques années, mais on avance petit à petit. On avait accueilli Chester Brown puis Charles Burns —avec une exposition— et ça s’était super bien passé ; et le mot se passe, et plus ça va et plus c’est facile d’avoir ses invités à Colomiers. C’est un travail de confiance, de bouche à oreille d’année en année.
Il y a aussi une rencontre avec Michael DeForge et Anders Nilsen cette année, Drawn & Quarterly reviennent avec un stand et d’autres éditeurs américains à qui ils ont parlé me demandent un stand pour l’année prochaine, ça fait boule de neige. C’est le réseau des gens qui sont contents de venir, qui reviennent et qui passent le mot aux autres.
L’affiche est signée Anna Haifisch, est-ce que tu veux en dire un mot ? Et nous dire comment vous l’avez choisie et comment vous choisissez les artistes en général ?
A.D. : C’est au coup de cœur ! Tous les ans, on réfléchit à quelqu’un qui sait faire de l’affiche et qui est dans notre ligne artistique. L’année dernière, on avait consacré une exposition à Anna Haifisch et l’accueillir à Colomiers c’était trop drôle, c’était trop bien, elle a adoré le festival.
Et ça nous semblait un peu évident de lui confier l’affiche cette année ; et pour la petite histoire, en arrivant à Colomiers —qui est une ville particulière, disons, en termes d’architecture— elle nous a dit quelque chose d’improbable : « franchement Colomiers ça me fait penser à Chicago, à une ville américaine. » Mais vraiment en venant à Colomiers te ne te dis pas ça ! Mais on s’est rappelé de ça au moment de faire l’affiche. Elle nous a fait une ambiance « États-Unis / diner américain » pour faire ce clin d’œil à ce premier ressenti.
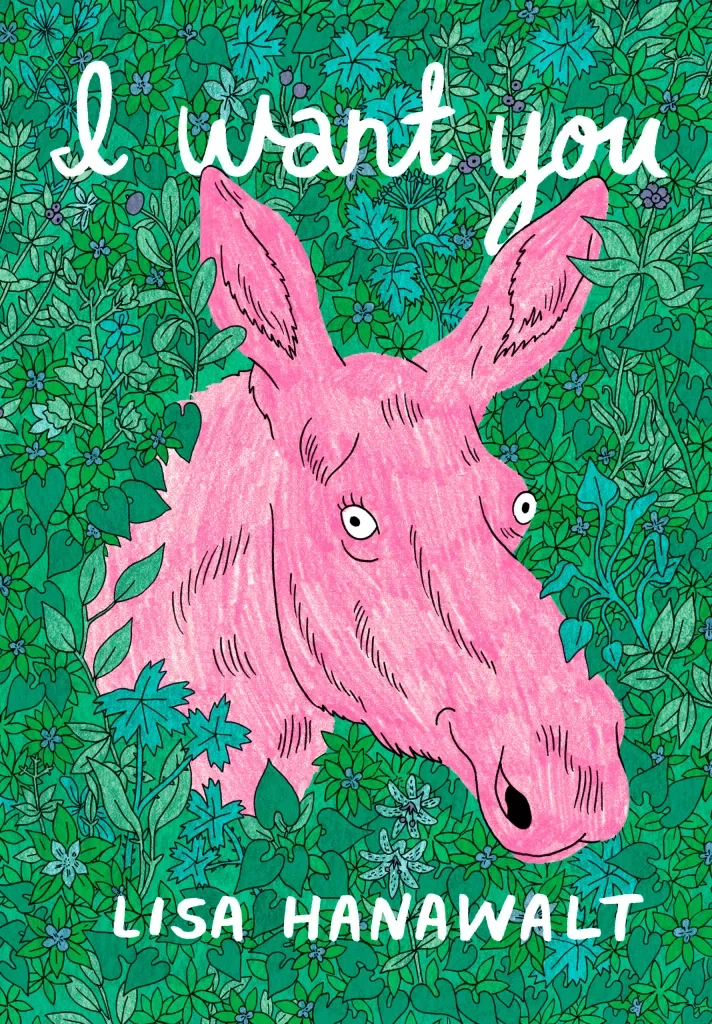
C’est marrant parce que ce n’est pas la seule. J’ai regardé les affiches des dix dernières années, elles tournent toutes autour du dépaysement, des grands espaces ou des jeux intérieurs/ extérieurs avec un esprit très « états-unien » …
A.D. : Oui, oui [rires] c’est trop marrant parce que ce n’est pas trop ça.
Celle qui est la plus proche, c’est celle de Jon McNaught, en 2014, avec la biche qui passe sur les petits pavillons, là on est plus dans la vibe.
Mais c’est bien que ça les inspire, en fait, j’envoie toujours les affiches des années précédentes aux artistes qui font l’affiche et je crois qu’il y a une espèce d’identité qui s’est créée sans leur demander de reprendre le même thème, ni les mêmes couleurs, ni un code, ni rien… Et je trouve que ce sont des affiches où on sait tout de suite que c’est BD Colomiers.
Pour fêter ces 40 ans, tu nous a parlé de la chasse au trésor, mais il y a aussi les COOLomiers, une remise de prix décalée, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
A.D. : C’est Damien et Guillaume, les éditeurs des éditions Misma qui vont animer la soirée. Il y a quelques années, ils nous avaient fait une fausse remise de prix, les Golden Globos, pour les auteurs et les autrices. C’était que pour le milieu et c’était tellement drôle qu’on a essayé d’imaginer la formule ouverte au plus grand nombre.
À Colomiers, on a un prix qui récompense un premier livre publié en français, le prix toute première fois, ils jouent avec ça et vont remettre que des prix inspirés de titres de chansons des années 80 : « Ça fait rire les oiseaux » pour les livres d’humour, « T’as le look coco » pour le plus beau livre… Et ils ont choisi que des livres d’auteurs et d’autrices qui seront à Colomiers.
Ils vont faire un grand spectacle humoristique avec ces remises de prix, en jouant avec le public et les auteurices qui seront là. Ce ne sera pas du tout moqueur, mais joyeux et festif.
J’espère qu’on pourra voir ça ou des extraits.
A.D. : On a tourné une vidéo, qu’on a pas encore vue, mais je pense que ça va donner [rires].
Quel serait ton conseil pour les festivaliers qui ne connaissent pas encore le festival ?
A.D. : Souvent, les gens qui ne connaissent pas le festival ont un peu peur d’aller dans les rencontres auteurs et autrices, allez-y. On y apporte un grand soin, on soigne les modérations et c’est 1h dans les fauteuils du cinéma pour découvrir l’univers d’un auteur ou d’une autrice qui donne envie d’aller découvrir tout le reste du festival. C’est souvent les habitués qui vont aux rencontres alors que c’est un super moment.
Je vous invite à ne pas avoir peur de vous poser une heure en écoutant un auteurice pour commencer et d’après enchaîner sur les autres propositions.
Pour y avoir été, j’ai adoré ce festival, ne le manquez pas si vous êtes dans la région, l’entrée est à 3€ (avec de nombreuses possibilités de gratuité) avec les expositions en accès libre, et les spectacles sont au tarif unique de 2€
Toute la programmation et les infos ici.
Thomas Mourier, le 25/11/2025
Interview d'Amandine Doche, directrice artistique du festival BD Colomiers
Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués.

22.11.2025 à 19:52
Aneta Kajzer expose un peu trop près du soleil chez Semiose
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2761 mots)
En 2021, Heavy Water inaugurait un premier volet avec une peinture dense, fluide, traversée de courants et de remous intérieurs. Deux ans plus tard, Head in the Clouds s’élevait vers des ciels plus légers, des formes en suspension, des visages flottants dans la couleur. Avec Too Close to the Sun, la trajectoire s’embrase, se poursuit en apothéose lumineuse et prend des allures d’ascension mythique.

Ce qui coulait ou s’évaporait se condense dans une chaleur irradiante : la matière atteint son point de fusion, là où la lumière devient couleur et la couleur, énergie. Le soleil d’Aneta Kajzer n’est pas un astre : c’est un bain de peinture, un foyer qui dilate et dissout les formes, irise et brûle comme si la couleur, portée au voisinage de son point d’ignition, gagnait un degré de liberté supplémentaire. Parfois, la stridence chromatique atteint une intensité presque électrique : les roses acides, les jaunes citron, les verts fluorés émettent leur propre lumière et la surface saturée d’énergie se fait écran solaire. Cette zone de surexposition invite la dissonance, revendique la collision de contrastes qui vibrent jusqu’à l’irréconciliable et tendent les harmonies au bord de la rupture. Dans ces passages presque trop lumineux, Aneta Kajzer s’aventure sur un territoire où peindre revient à risquer la brûlure pour atteindre la clarté. Too Close to the Sun met à nu ce moment précis où la peinture devient une météorologie instable, un point critique au-delà duquel les vents de brosse, les pluies de pigments, les bouffées d’oxydation rouge-orangé, les brumes de pastel et les nappes d’ombre refroidie ne tiendraient plus dans l’atmosphère et se condamneraient à une inexorable chute. Rien n’est planifié : la forme advient dans le flux, se laisse guider par les réactions de la matière, par l’équilibre fragile entre geste et retrait. C’est une peinture de veille et d’attention, une peinture qui guette ses propres révélations. La figure n’apparaît jamais comme une décision préméditée mais comme une apparition lente née du climat du tableau. Elle surgit de la couleur comme d’une nébulosité, à la faveur d’un hasard contrôlé, d’une coulure arrêtée au bon moment, d’un frottis qui soudain prend sens dans un élan mélancolique ou, au contraire, dans une pirouette humoristique un peu effrontée. La figure se devine avant de se reconnaître, comme un visage entrevu dans un nuage ou un reflet d’eau, trouvée plutôt qu’inventée. Pareille à l’observateur de nuages qui distingue une tête, un profil, une bête, l’artiste traque la ressemblance fugace et laisse la paréidolie ouvrir la scène : un trait, une goutte épaisse, une griffure métallique tracée avec le bord du tube esquissent les contours d’un visage et, l’instant d’après, s’évanouissent dans l’abstraction d’une figure ectoplasmique. Sur Doppelgänger (« Double ») une masse bleu outremer vire en cheveux, une effigie en smiley enfantin est surplombée par une seconde figure inquiétante, composée par une arche violette qui courbe l’espace et dont l’œil/point révèle un être dédoublé : deux faces, deux régimes (dessin/peinture) coexistent comme deux humeurs simultanées. Avec Harvest (« Moisson »), un visage-paysage orangé piqué de taches sourit en coin, baigné de souffles bleu nuit ; le vert tendre s’ouvre en colline liquide : la paréidolie est franche et assumée, la nature prend figure et la figure reprend nature, dans une analogie avec certaines peintures nuagistes de Jean Messagier.
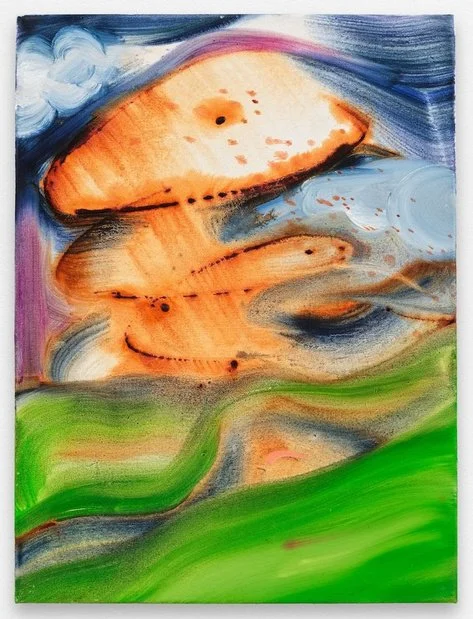
Aneta Kajzer, Harvest, 2025 Courtesy de l’artiste et Semiose, Paris
Les œuvres d’Aneta Kajzer se composent en états successifs de saturation/décantation, de lourdeur/légèreté, d’apparition/disparition mais aussi de figuration/abstraction, en maintenant les deux régimes en tension pour qu’aucun ne l’emporte sur l’autre. Cette oscillation n’est pas un compromis mais une position, une manière d’habiter la peinture là où elle se pense encore. La dichotomie entre abstraction et figuration n’a pour Aneta Kajzer aucune pertinence et relève d’un vieux partage hérité d’un temps où l’on croyait encore que la peinture devait choisir entre le monde et elle-même. Elle peint dans l’après-coup de cette histoire, à un endroit où les formes et les flux, les silhouettes et les taches, appartiennent à un même continuum. Le visible et le sensible s’y confondent, la couleur engendre la figure comme un son engendre sa résonance, la peinture est le lieu d’une circulation incessante entre ce qui se montre et ce qui se dissout. La peinture d’Aneta Kajzer emprunte autant à la liberté des lavis et des champs colorés d’Helen Frankenthaler qu’à la figuration de Maria Lassnig, Miriam Cahn ou Nicole Eisenman qui sont pour elle de véritables héroïnes. Ce n’est pas l’abstraction qui succède à la figuration, ni l’inverse : c’est leur respiration commune qui fait naître le tableau. Un coup de brosse long devient mèche ; une coulure brune se fond en rideau de pluie ou de cheveux ; deux points noirs ouvrent des yeux ; une bouche est un cadmium renversé ; un simple appui du métal du tube creuse la ligne qui manquait dans un dessin sans crayon. Cette économie est l’alliée d’une luxuriance qui, à peine éclose, travaille à s’évanouir. Les personnages ont leurs humeurs — componction, sourire léger, douceur… — et acceptent de n’être que des hypothèses, des êtres de survenue — mais n’est-ce pas là finalement une caractéristique de nos fatalités communes ? Icare n’est pas très loin, symbole de ce fragile élan vers la lumière qui finit toujours par se consumer.
Enfin, sans doute n’est-il pas anodin de noter qu’un certain nombre de titres se réfèrent à la musique, une musique que l’on ne peut dès lors s’empêcher d’entendre devant les peintures : Auf Wanderschaft (Felix Mendelssohn, 1845), Space Oddity (David Bowie, 1969), Stairway to Heaven (Led Zeppelin, 1971), Harvest (Neil Young, 1972), All Over the Place (The Bangles, 1984), Slippery Slope (The Dø, 2011), Beam Me Up (Midnight Magic, 2012), Cringe (Awkward Marina, 2024), jusqu’à They Lost Control qui évoque le She’s Lost Control de Joy Division (1979). Chacune de ces peintures impose alors un tempo, de la ballade astrale au riff électrique, de la mélancolie à l’exultation disco. Dans ce mix, la peinture passe d’une réverbération laiteuse (les fonds pastel) à une distorsion (les rouges oxydés), d’un silence (les blancs laissés vides) à un break (la ligne au tube). La musique n’est pas un thème secondaire : c’est une manière de dire que la peinture s’écoute autant qu’elle se regarde, que ses rythmes — coulures, coups, reprises — sont déjà des décisions de forme.
Auf Wanderschaft (« En voyage »), la peinture la plus mélancolique de ce corpus récent, avance par nappes d’abricot brûlé et de cendres. Aneta Kajzer semble avoir traduit en peinture le moment suspendu évoqué dans les strophes de la musique de Felix Mendelssohn — celui du départ, du regard jeté en arrière, du geste de la main qui s’efface dans la distance : « Je pars en voyage vers des contrées lointaines ; je me retourne une dernière fois, ému, et je la vois remuer les lèvres, et me faire signe de la main1. » Le tableau s’ouvre sur un vaste dégradé d’orangés et de roses, espace tiède et vibrant dévoilant au centre une forme pâle, visage fantomatique en effacement dans la lumière blême. Le pan vertical de rose agit comme une coulée d’émotion, une voix qui se perd, tandis que la fine courbe verte jetée d’un geste rapide traverse l’espace comme un ultime éclat. À la manière de Felix Mendelssohn, Aneta Kajzer fait de la séparation une modulation du sentiment, un adieu qui continue à vibrer dans la couleur, une voix qui laisse son écho dans la lumière.
Dans Stairway to Heaven, les arabesques rousses, striées de coulures, ruissellent comme une pluie d’ambre descendue d’un ciel jaune pâle nimbé d’un marbre céleste empourpré. Des arcs et des motifs presque imperceptibles dessinent des bouches, des yeux, des fronts : des visages passent comme des apparitions météoriques. Le violet, en lisière, souffle son contrechant ; la peinture met en scène sa propre pesanteur jusqu’au cramoisi, base terrestre et organique sur laquelle repose ou s’élève le reste de la composition. Le rouge brun est charnel, matière épaisse de veines sombres, traînées figées comme du sang coagulé ou de la résine brûlée. Les couleurs, oscillant entre l’ombre et la braise, opposent à la clarté du haut du tableau — lavandes, jaunes laiteux, chairs rosées — un contrepoids de densité tellurique. Cette tension entre le haut et le bas, le lumineux et l’opacifié, rejoue le mouvement du titre, indique une ascension contrariée. Ces « marches vers le ciel » sont un passage vers la lumière qui doit se détacher d’un monde visqueux et terrestre.

Space Oddity condense la peinture en bouilloncosmique primordial, livre l’étrangeté spatiale du fond diffus de la couleur. Les pigments liquides migrent entre violet, fuchsia et jaune crème ; des filaments et de minuscules halos prolifèrent ; la peau du papier boit la couleur jusqu’à la transparence. Comme dans le titre de David Bowie, tout semble suspendu entre apesanteur et vertige, entre flottaison et dissolution: « And I’m floating in amost peculiarway / And the stars look very different today. » La peinture devient un champ gravitationnel où chaque teinte cherche sa propre orbite : le violet dense attire le regard vers un noyau sombre tandis que les roses et les jaunes diffus s’échappent vers les bords comme si la lumière tentait de quitter la matière. Il n’y a ni haut ni bas, ni orientation stable, seulement des zones de densité et d’évanescence, des forces de dispersion et d’absorption. La peinture agit comme une nébuleuse galactique encore tiède, les taches se dédoublent, les frontières se dissolvent et dans cet espace flottant résonne une solitude presque métaphysique — celle, peut-être, de Major Tom, l’astronaute de David Bowie, livré à la beauté du vide, ou celle d’Aneta Kajzer constatant, encore et toujours, la beauté étrange de l’espace pictural.
Jean-Charles Vergne, le 25/11/2025
Aneta Kajzer - Too close to the sun -> 24/12/2025
Galerie Semiose , 44, rue Quincampoix 75004 Paris
22.11.2025 à 19:42
Concours : sous l’arc de la Défense, la tombe de l’architecte inconnu ?
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1978 mots)
Avec les films « The Brutalist » et « L’inconnu de la Grande Arche » successivement à l’affiche, il est question d’architecture dans les gazettes grand public. Lequel public ne verra pas cependant que le premier est une imposture* et le second l’expression d’une nostalgie, quand de grands bâtiments publics de la République apparaissaient à l’issue d’un concours d’idées (bon pas tous, pour I.M. Pei, la Pyramide, c’était cadeau).

Le grand public comprend pourtant, même confusément, que la Grande Arche et Beaubourg sont certainement les bâtiments contemporains de Paris les plus connus et célébrés dans le monde, deux ouvrages imaginés par des architectes alors inconnus au bataillon. Nostalgie donc car chaque architecte français sait que la construction, la conception même, de la Grande Arche et du Centre Pompidou serait impossible aujourd’hui en France car tant Johan Otto von Spreckelsen que les jeunes Renzo Piano et Richard Rogers seraient bien en peine de témoigner de quelconques références, à part deux ou trois églises pour le premier et des croquis d’étudiants pour les deux autres. Le génie, par définition, arrive toujours dans l’angle mort des habitudes et discours compassés.
Aujourd’hui, dans les règlements de concours, la multiplication des critères et l’exigence de références toujours plus extravagantes rendent caduque l’idée même de sélection, donc de choix éclairé. Encore moins du choix éclairé d’un projet à partir de l’esquisse d’un concours anonyme.
Déjà en 2019, le règlement du concours pour le futur Hôpital universitaire du Grand Paris Nord (HUGPN) – un équipement qui doit être mis en service au troisième trimestre 2028, « au plus tard » (sic) – n’imposait rien de moins que six conditions. La première : « avoir déjà conçu une opération hospitalière en activité de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), avec plateau technique, d’une surface dans œuvre d’au moins 65 000 m², dont l’avancement sera au minimum au stade du PC déposé, le candidat fournira le formulaire PC justifiant de la Surface de plancher (SDP) du projet, ou achevée depuis moins de 5 ans ». Ce n’est plus une demande de références, c’est une grande faucheuse !

Les cinq autres références sont à l’avenant, toutes « de moins de 5 ans ». C’est vrai qu’à la vitesse à laquelle sont construits les projets en ce pays, une référence valable aujourd’hui ne l’est déjà plus demain. Vu ainsi, il est clair que l’architecte un peu audacieux et imaginatif a plus de chance de devenir footballeur professionnel ou d’aller sur la lune que de gagner un gros hôpital en France !
Admettons que pour un équipement hospitalier, qui demande une grande technicité et qui engage la vie ou la mort des usagers, il est compréhensible que le maître d’ouvrage veuille faire appel à qui maîtrise déjà les règles de l’art. Sauf que ces critères se sont depuis largement généralisés. À preuve, l’agence espagnole RCR, prix Pritzker 2017, serait bien en peine de construire un nouveau musée en France, le remarquable musée Soulage datant de 2014 ! S’il ne s’agissait que des musées… C’est désormais la même tambouille improbable qui décide de n’importe quel projet, et ce n’est pas la taille qui compte comme on dit chez Dorcel ! Certes, concevoir et construire une école de trois classes n’est évidemment plus à la portée du premier architecte venu n’ayant pas déjà livré dix groupes scolaires lors des trois dernières semaines avant noël.
Autrement dit, soit l’agence cartonne à grande échelle – depuis cinq ans au moins – dans son domaine particulier et exclusif, soit ce n’est pas la peine de faire perdre du temps à tout le monde. En clair, si vous avez l’habitude des musées, il ne sert à rien d’aller embêter les spécialistes des écoles, des gymnases ou des usines de retraitement des déchets. Chacun chez soi et les projets seront bien gardés. Et quelles agences cartonnent ? En tout cas, la plupart des Grands Prix français de l’architecture ne peuvent prétendre concourir, ni à un hôpital ni à un musée, un groupe scolaire ou un gymnase en province. Trop d’imagination peut-être en regard de critères qui in fine ne visent qu’à l’uniformisation et la répétition de la médiocrité, sans ressort et sans imprévu.
D’ailleurs, histoire de bien calmer l’ardeur des impétrants créatifs et iconoclastes, demeure toujours la mention du bilan financier. Ainsi, il suffit au maître d’ouvrage d’estimer que, pour pouvoir concourir, l’agence doit faire montre d’un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1, ou 2 ou 3 ou 14 millions d’euros selon affinités – depuis cinq ans au plus pour faire bonne mesure – pour régler leur sort aux insolents.
Il fut un temps pas si lointain – d’aucuns s’en souviennent – quand pour un concours, le maître d’ouvrage recevait, disons, entre 50 et 300 candidatures. Ensuite des fonctionnaires, compétents et motivés, armés d’un jury de sachants, passaient des jours entiers à décortiquer les dossiers, plus ou moins bien et plus ou moins vite certes en fonction de leurs propres préjugés et des désirs du maître d’ouvrage et/ou du maire mais, à la fin, au moins deux ou trois, sinon les quatre, des équipes sélectionnées étaient le résultat d’un choix construit, débattu, argumenté et assumé. Il fallait des femmes architectes, il fallait des jeunes, il fallait des stars, etc. Il s’agissait en tout cas d’un acte intellectuel que le maire ou maître d’ouvrage pouvait plus tard expliquer et justifier à ses administrés. À défaut de concours d’idées, c’était déjà ça !
Aujourd’hui, si la maîtrise d’ouvrage prend des mois à annoncer le lauréat, en réalité, aujourd’hui, de critère 1 à critère 6, en trois heures, il ne reste aux fonctionnaires indolents que six ou sept candidatures à examiner et, en fonction des désirs du maître d’ouvrage, l’affaire est pliée en une après-midi. Avec l’IA, ce sera désormais réglé en 30 secondes chrono ! Paresse des services ? En tout cas, pour les politiciens pusillanimes, voilà l’architecture passée d’une logique de choix éminemment politique à une logique d’élimination tandis qu’une démarche intellectuelle, aussi fragile soit-elle, est devenue un algorithme aussi dénué d’intelligence que possible.
Même les promoteurs agissent par choix, pour de bonnes ou mauvaises raisons, parce qu’ils apprécient cet architecte ou parce qu’ils savent que cet autre sera un béni-oui-oui, mais au moins c’est un choix et, le plus souvent, ils se fichent comme d’une guigne de savoir combien il y a de gens à l’agence du moment que ça tourne.
S’agit-il donc simplement pour les maîtres d’ouvrage publics de gagner du temps ? Parce que trois jours de réflexions un peu sérieuses pour étudier cent dossiers au lieu de six, pour un projet qui mettra de cinq à dix ans à se construire, serait trop demander aux services évidemment débordés ?
Ou peut-être manque-t-on désormais de fonctionnaires et d’élus compétents ? Ce qui expliquerait pourquoi ceux incapables de mesurer le sens de l’architecture dans un projet préfèrent s’en remettre de façon obtuse et prudente aux tableaux de références qui ont cours partout, quel que soit le lieu où sera construit l’ouvrage et sa dimension. Prise de risque = 0 et vivons heureux. Pas étonnant que les bâtiments eux-mêmes finissent par ressembler à des tableaux Excel.
Christophe Leray, le 25/11/2025
22.11.2025 à 19:31
Bonampak, une archéologie mexicaine sans paquet cadeau
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3491 mots)
Dans les plis et replis de l’histoire de la « découverte » d’un site archéologique célèbre au Mexique, des visions du monde qui se heurtent et se déchirent. Un roman alerte et passionnant.
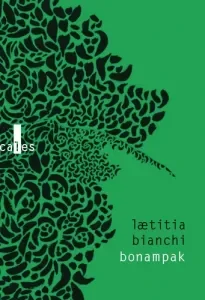
Qui trouve les pyramides et les trésors à l’intérieur des pyramides ? La réponse m’a longtemps semblé évidente : les explorateurs, les aventuriers, les archéologues – une limite floue entre ces catégories –, les Indiana Jones. Un homme à pied ou à cheval, parlant toutes les langues, maniant toutes les épées, ouvrant tous les chemins, disposant d’assez d’intuition pour tomber sur les stèles, et d’assez de générosité pour les remettre au musée du coin – le British Museum.
J’étais naïve. De cette naïveté qui n’est pas seulement ignorance. De cette naïveté qui est flemme aussi, absence de questionnement, tranquillité du visiteur charmé et repu qui vient voir ce qu’il y a à voir, comme si la géographie et l’histoire étaient un panier de pommes sur une table. Il y a quoi à faire, dans le coin ? – et les innombrables guides de voyage répondent.
Souvenir d’un cours d’histoire : on nous racontait le voyage officiel d’une reine ; de hauts murs avaient été construits le long de son passage pour cacher ce qu’elle ne devait ni voir ni savoir. Tous, du haut de nos dix ans, on s’esclaffait : comment n’avait-elle rien vu, la reine ? Etait-elle bête, cette reine ! Ne pas reconnaître des murs montés à la hâte, croire aux slogans de bienvenue ! Quelle idiote, cette reine ! Mais les murs du regard chacun se les bâtit, les œillères sont intérieures et nous voilà notre propre voyageur officiel, accueilli en grande pompe, et désireux de beaux clichés, parmi la vacance du questionnement.
Les lendemains de ma première visite de Bonampak – ces lendemains furent des années –, j’ai fait l’idiote. À chacune de mes phrases, je mettais un point d’interrogation. J’eus longtemps l’âge du pourquoi.
Pourquoi Bonampak ? Pourquoi m’étais-je retrouvée un matin à Bonampak, seule, éblouie, dans la lumière blanche de la forêt lacandone ? Parce que Bonampak était un site archéologique maya digne d’être vu. Pourquoi digne d’être vu ? Parce qu’on pouvait y voir des peintures extraordinaires. Pourquoi pouvait-on y voir ces peintures ? Parce qu’un certain Giles Greville Healey les avait découvertes. Pourquoi Giles Healey les avait-il découvertes ? Parce qu’il se trouvait là en 1946. Pourquoi se trouvait-il là en 1946 ? Parce qu’il tournait un documentaire sur les Mayas. Pourquoi tournait-il un documentaire sur les Mayas ? Parce que la United Fruit Company le lui avait demandé. Pourquoi la United Fruit Company, entreprise bananière,la plus puissante multinationale des Etats-Unis, finançait-elle un documentaire sur les Mayas ? Je n’avais pas de réponse. Alors je reprenais. Pourquoi étais-je à Bonampak, où un Lacandon assis sur les marches du temple aux fabuleuses peintures pianotait sur son téléphone portable, gardant vaguement l’entrée ? Parce que Giles Healey avait découvert Bonampak. Pourquoi Healey avait-il découvert Bonampak ? Parce que ses amis lacandons l’y avaient conduit – c’était écrit dans les guides. Pourquoi Giles Healey avait-il des amis lacandons ? Je n’avais pas de réponse.
Le site mexicain de Bonampak (« murs peints » en maya, nom donné par l’archéologue Sylvanus Morley), ensemble relativement modeste de vestiges de la civilisation maya, est situé à une trentaine de kilomètres de celui de Yaxchilán, beaucoup plus imposant, près de la frontière du Guatemala. Il doit sa notoriété mondiale à ses fresques, « découvertes » par l’Occident moderne en 1946. Au cœur de la jungle lacandone de l’État du Chiapas (chère aux néo-zapatistes de l’EZLN et à l'(ex-)sous-commandant Marcos, le site était bien connu des indigènes avant d’être remis au goût du jour archéologique dans des circonstances à la fois terribles et rocambolesques, dans lesquelles les rivalités entre scientifiques professionnels ou sensationnalistes, coureurs de jungle, aventuriers et proto-beatniks ne le cèdent en rien aux menées plus ou moins souterraines de factions politiques et, surtout, de la multinationale tentaculaire à l’époque qu’était United Fruit, véritable empereur économique de l’Amérique Centrale sous domination yankee (ainsi que le rappelait comme incidemment le grand Hans Magnus Enzensberger dans son « Politique et crime » de 1964). C’est à l’histoire de cette redécouverte, et aux vertiges qu’elle ne peut qu’occasionner, que nous convie l’autrice et éditrice franco-mexicaine Lætitia Bianchi, avec ce « Bonampak » publié en mars 2025 aux éditions Verticales.

Vous êtes à l’orée de la forêt lacandone, page 1, comme dans ces Livres dont vous êtes le héros que l’on ouvrait enfant, les dés serrés dans la paume, pressentant le danger et la chance, impatients de la présence de créatures malfaisantes ou amies que l’on savait tapies entre les pages. Vous marchez dans la forêt. Mais quel étranger marcherait ainsi, seul, dans la forêt lacandone ? Pas de carte, pas de wifi, pas de panneaux indicateurs de trésors. Et le boire, et le manger ? Et le matériel, si matériel il y a ? Et les mules pour le transporter, si mules il y a ? Et l’argent pour payer les mules ? Et les sentiers ? Et d’ailleurs, pourquoi y aurait-il des sentiers ? Qui aurait l’idée de tracer des sentiers en pleine jungle ? La métaphore de l’aiguille dans la botte de foin, transposée sous d’autres tropiques, devient celle de la pyramide dans la botte de jungle : la proportion est-elle la même. Nul besoin de calculs pour comprendre qu’on ne butte pas au hasard sur une pyramide. La probabilité, pour un explorateur étranger, de trouver Bonampak au hasard d’une promenade n’est pas dérisoire : elle est nulle. Il faut donc des guides. Des informateurs. Des fixeurs, comme dit le jargon journalistique. Des indigènes à qui on enlève trois lettres : des Indiens. Des gens du coin. Des sauvages. Mais des sauvages suffisamment peu sauvages pour vous répondre. Il faut de l’intuition (un peu), de la patience (beaucoup), du courage (évidemment), du cynisme (parfois), le désir de gloire (sans doute), et des relations dans le monde (of course). Après seulement on fait la Une des journaux.
Les fresques avaient été étudiées, analysées, interprétées. Il y avait eu des dizaines de livres. Des sommes archéologiques sagement rangées dans les bibliothèques les plus prestigieuses d’Amérique. Des articles de magazines (Mayas ! explorateurs ! Indiens ! trésors !), étayés de citations tronquées et de sources hasardeuses. Des guides et des écrans touristiques avecleurs étoiles, leurs enthousiasmes (incontournable !) ou leur mépris (si on a le temps). Les à-côté des guides, les avis des uns (grosse déception, on voit mal les peintures) et les avis des autres (formidable ! super trip dans la jungle). Carte postale sur frigidaire ou livre d’art sur étagère.
Il y avait même eu ce mot, bonampakitis, affublant du nom d’une maladie imaginaire les passions déclenchées par Bonampak, par le fait que tout un chacun ait son mot à dire sur la découverte de Bonampak et sur la mort – non : sur l’assassinat, on le savait peut-être, on le savait sans doute, on ne le disait pas encore – de Carlos Frey. Bonampakitis. Le mot avait été créé en 1952 par un autre protagoniste de cette histoire, l’archéologue Frans Blom. La bonampakitis, disait Frans Blom, était une maladie littéraire, hautement contagieuse. Et voici que sur un autre continent, de l’autre côté de l’Atlantique et plus de soixante-dix ans après les faits, j’avais contracté une forme virulente de bonampakitis. La sensation que des pans entiers de l’histoire convergeaient dans ces quelques mètres carrés de jungle en était le symptôme le plus évident. J’aurais pu laisser passer cette fièvre exotique de savoir, manger des cédrats et des pistaches et ranger parmi mes souvenirs personnels l’émoi de ma première visite de Bonampak, à l’aube – mais.

Dans les plis et replis de la saga Indiana Jones de Steven Spielberg, la conception romantique et héroïque de l’archéologie occidentale conduite en forêt vierge, derrière le film d’aventures à gros budget et les prouesses de Harrison Ford dans le rôle-titre, est déjà fortement questionnée, pour qui sait regarder entre les plans principaux. À propos de Bonampak, Lætitia Bianchi pousse les curseurs de démythification quasiment au maximum possible.
À travers les parcours de (re-)découvreurs, professionnels ou accidentels, de Frans Blom, de Carlos Frey, de Gilles Healy et de John Bourne, c’est toute une économie souterraine et une formidable instrumentalisation de l’art et de son histoire, du regard porté sur la colonisation réputée ancienne et sur l’exploitation économique déterminée et parfaitement contemporaine (des questions qui se trouvent d’ailleurs, sans aucun hasard, à l’un des points névralgiques des revendications néo-zapatistes au Chiapas) qui sont mises à jour, elles aussi. Ruines d’avant 1946 aux gigantesques ombres portées et aux conséquences interprétatives plus que jamais actuelles, les fresques de Bonampak, baignant dans le jus extractiviste de l’acajou, du pétrole et du latex spécifiquement destiné au chewing-gum (mis en évidence dans un flashback des plus tristement savoureux), deviennent un marqueur et un témoin de quelque chose de profondément ancré, les englobant et les dépassant, du côté de la domination froide et, de facto, quasiment automatisée.
Et c’est en dissimulant tout le sérieux de son investigation historique sous une tonalité frisant joliment le bucolique et le burlesque (le Julien Blanc-Gras de « Gringoland » n’est parfois pas si loin, surtout au début du roman, non plus, presque paradoxalement, que le Paco Ignacio Taibo II de « Jours de combat ») que Lætitia Bianchi nous offre ici une œuvre politique et socio-économique de tout premier ordre.
xk xk xkiii. Il y a un oiseau, mais il n’y a pas dans les lettres de notre alphabet de quoi écrire le cri de cet oiseau. Il pleut, mais il ne pleut pas de la pluie. Les gouttes sont larges comme la paume de nos mains, parfois plus. Parfois les gouttes ont des doigts, parfois elles sont rondes et jaunes. Elles tombent de très haut. Elles tombent de plus haut que la hauteur du premier building des États-Unis, elles tombent de douze étages ; le treizième étage c’est le ciel. Ce n’est pas de la pluie, non. Qu’est-ce que c’est ? C’est la pluie qui n’est pas la pluie. Ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles les plus hautes qui tombent et qui en tombant sur les branches des étages inférieurs de la forêt, font ce bruit de pluie épaisse. Xk xxk. Les arbres sont plus hauts que les plus hauts des buildings qui n’existent pas encore. Xk xxk kkkx. Sur les troncs des arbres il y a des traces de doigts, et ces doigts bougent lentement : c’est la lumière bercée par les feuilles. Les feuilles sont vitraux de cathédrales mais les cathédrales n’existent pas encore. Les rayures de soleil peignent et repeignent les feuilles, et les feuilles se laissent peigner et peindre de leurs doigts entrelacés. Xk xxk kkhha xk. Une fourmi au cul doré grand comme un pépin de sapotillier avance, chantant l’ampleur du tableau. Kkhha xk. Le soleil n’est pas seul. Sous le soleil que nous appelons soleil, deux soleils volent en contre-bas, au troisième étage du ciel, dans la pluie qui n’est pas la pluie. L’un se pose sur une branche. Il a plongé sa bouche dans du rouge vif. xk xkii xkiii. Dans nos mots, il n’y a pas de quoi nommer ses couleurs. On appelle cela un toucan.
Le Mexique ne s’appelle pas encore le Mexique. La forêt lacandone ne s’appelle pas encore la forêt lacandone. Bonampak ne s’appelle pas encore Bonampak. Et pourtant tout cela existe, et les soleils, et les couleurs, et les toucans, xk xk xkiii. Nos pauvres lettres de l’alphabet ne savent rien de cela encore.
Hugues Charybde, le 25/11/2025
Laetitia Bianchi - Bonampak - éditions Verticales
l’acheter chez Charybde, ici

18.11.2025 à 09:23
Passé sous le radar : les vibes de Khan Jamal
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1102 mots)
Si, en parlant vibraphone jazz, les premiers noms qui viennent à l’esprit depuis les 60’s sont plutôt Bobby Hutcherson, Roy Ayers ou Gary Burton, après Lionel Hampton, Milt Jackson ou Cal Tjader, il s’agirait aussi, dans le registre spiritual, de ne pas oublier Khan Jamal dont la ressortie de Give the Vibes some au Souffle Continu remonte d’une pile. Avec l’idée de base du Give the drummer some adaptée aux lamelles qui swinguent. Un genre de perle à la résonance aussi métallique que spatiale. Rentrez les tobogans !
Sur ‘’Cold Sweat’’, James Brown lançait son légendaire “give the drummer some.’’ En 1974, le vibraphoniste de Philadelphie Khan Jamal lui emboîtait le pas avec Give the Vibes Some et le résultat est saisissant. Le label PALM, fondé par le pianiste et compositeur Jef Gilson, offre à Jamal le terrain idéal pour explorer en profondeur les possibilités du vibraphone contemporain. Créé en 1973, PALM s’impose vite comme un label qui ne publie que des enregistrements atypiques. Give the Vibes Some, dixième sortie du label, en est une éclatante illustration.
Originaire de Philadelphie, Khan Jamal se tourne vers le vibraphone en 1968, après deux années passées dans l’armée, entre la France et l’Allemagne. Séduit à la fois par l’instrument et par le style de Milt Jackson, figure emblématique du Modern Jazz Quartet, il étudie auprès de Bill Lewis, légende locale du vibraphone. Il fait ensuite ses premiers pas sur la scène jazz de Philadelphie, où il s’impose rapidement.
Début 1972, Khan Jamal enregistre pour la première fois avec le groupe Sounds of Liberation, qui propose une singulière fusion entre le groove des congas et l’improvisation issue du jazz d’avant-garde. Le saxophoniste Byard Lancaster, figure clé dans le parcours artistique de Jamal, apporte une contribution essentielle à ses explorations en solo. Quelques mois plus tard, toujours en 1972, Jamal signe ses débuts en tant que leader avec Drum Dance to the Motherland, une performance live audacieuse, marquée par un traitement spécifique, autour des réverbérations et des saturations des sons, une expérience unique, qui n'a jamais été reproduite par la suite. Ces deux enregistrements paraissent sur Dogtown, un petit label indépendant géré par des musiciens.
‘’Nous ne pouvions décrocher aucun engagement, ni concerts, ni sessions d’enregistrement, rien du tout. Alors, je suis parti pour Paris’’, raconte Jamal dans une interview accordée à Cadence avec Ken Weiss. ‘’En quelques semaines, j’avais publié quelques articles et obtenu une séance d’enregistrement. Une situation qui n'améliore pas mon sentiment vis-à-vis de l’Amérique.’’ C’est en 1974, à l’époque où Byard Lancaster enregistre la musique aujourd’hui rassemblée dans The Complete PALM Recordings (1973-1974) publié par Souffle Continu.
La séance d’enregistrement de Jamal donne naissance à Give the Vibes Some. À l’origine, il s’agit d’un album d'exploration du vibraphone en solo, mais deux titres sont enrichis (grâce à une astuce technologique ?) par la participation d’un célèbre batteur français, habituellement audible au piano ou derrière les fûts à chanter en kobaien… . Sur un autre morceau, Jamal délaisse le vibraphone pour son ancêtre en bois, le marimba, et invite le jeune trompettiste texan Clint Jackson III. Durant ce séjour en France, l’article le plus marquant consacré à Jamal paraît dans Jazz Magazine, sous forme d’interview. Ses derniers mots sont : “The Creator has a master plan / drum dance to the motherland.” On peut y ajouter comme formule programmatique : “Give the vibes some.”
On ajoute que, pour un album méconnu ( de nous jusqu’ici…), il sonne comme pierre angulaire. de ce jazz développé par les 70’s que le terme “spiritual” ne recouvre qu’en partie et, comme un album qui aurait du faire partie de toute bonne discothèque. Et ce, dès sa sortie. C’est (peu) dire !
Jean-Pierre Simard, le 18/11/2025
Khan Jamal - Give the Vibes some - Palm Redux Serie - Souffle Continu
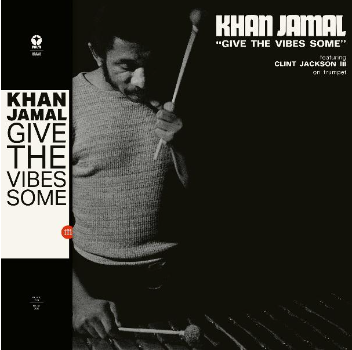
17.11.2025 à 19:17
Des amours artificielles au Japon expliquées par leur écrivaine même
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4760 mots)
A l’anthropologue Agnès Giard, chercheuse rattachée à l’Université de Paris Nanterre, auteure de Les Amours artificielles au Japon (Albin Michel, octobre 2025) on a voulu poser des questions, suite à la lecture, pour nous tourneboulante, de son livre. On s’accroche, c’est du brutal. Let’s go !

Copyr. Share Wedding
LAQ :Comment le ralentissement économique du Japon a-t-il bien pu déterminer les nouveaux comportements de vie amoureuse virtuelle – et pourquoi ?
Agnès Giard : Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, les nouvelles générations ne veulent ou ne peuvent plus se marier parce que le mariage repose sur un modèle que la crise a rendu inadéquat. Ce modèle, c’est celui de la femme au foyer et de l’homme assurant la principale source de revenu. Ce modèle ne peut fonctionner que si l’homme gagne au minimum 5 millions (28 000 euros) de yens par an, or seuls 15% des Japonais ayant la vingtaine atteignent ou dépassent cette somme. A peine 37% dans la tranche d’âge au-dessus.
Les salaires ayant baissé, les emplois étant devenus précaires, un nombre croissant d’hommes sont donc exclus du marché matrimonial. Par ailleurs, beaucoup de femmes refusent de devenir femme au foyer et de se mettre au service d’un mari qui pourrait tout aussi bien perdre son travail ou divorcer. Pour ces raisons et bien d’autres encore, la plupart des jeunes refusent de s’engager. Ou, tout simplement, n’y parviennent pas, faute de moyens, faute de partenaire.
Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial ingrat, certaines personnes tentent de trouver le bonheur autrement, avec les moyens du bord. Que faire quand on se sait condamné à mourir seul et sans descendance ? La plupart de mes interlocuteurs au Japon me disent que l’amour « dans la tête » procure des émotions réelles. Pour eux, aimer un personnage, c’est une façon de faire face à une situation sans issue.

Mariage de Kondō Akihiko avec Hatsune Miku p. 145 © kondo akihido.
LAQ : Plus précisément, comment une démarche de couple est-elle devenue quasi impossible économiquement – et pourquoi cela a-t-il rendu les relations virtuelles ?
Agnès Giard : Le gouvernement japonais estime que d’ici 2030 un homme sur trois et une femme sur cinq seront célibataires à vie. Avec la nomination de Sanae Takaichi qui invite « tout le monde à travailler dur », en ajoutant qu’elle va elle-même sacrifier sa vie privée pour « travailler, travailler, travailler et travailler », la situation semble sans issue : faire carrière étant incompatible avec une vie familiale, les hommes et femmes se sentent pris en otage d’un système qui dysfonctionne. Les uns se sentent piégés dans le mariage, les autres souffrent d’en être exclus. Aucune alternative ne se présente vraiment… pour le moment du moins.
Plutôt que de baisser les bras, certains individus reportent leur affection en direction ce qu’ils appellent «la Deuxième Dimension» (ni-jigen), c’est-à-dire l’espace des écrans, des mangas et des consoles de jeu. Il me semble cependant important de souligner que cette pratique ne concerne qu’une petite minorité de personnes au Japon. Les personnes qui s’engagent dans des relations amoureuses « illusoires » le font à des degrés d’investissement variés et les chiffres avancés par les agences marketing sont à prendre avec des pincettes. Personnellement, je ne cite ces chiffres qu'au titre de révélateurs : ils traduisent bien le goût des médias japonais (entre autres) pour la surenchère… autour d'une pratique qui reste encore très mal-vue.
Selon une étude datant du 31 janvier 2025, réalisée par CDG et l'agence Oshicoco sur 23 069 personnes âgées de 15 à 69 ans, 14 millions de personne (soit 11% de la population) possède un « objet d’amour inaccessible » (oshi). Le mot oshi regroupe pêle-mêle des idoles réelles et virtuelles, des acteurs, des héros de manga ou d’anime, des VirtualTubers et des champions de sport… Qu’il s’agisse d’humains ou de personnages, les oshi relèvent de l’« amour illusoire » (mōsō ren’ai). Le mot présente ceci d’intéressant qu’il invalide la distinction vrai/faux, en montrant que l’amour fabulé mobilise et génère des émotions réelles. Que l’objet de désir soit en chair ou en pixel revient au même : dans tous les cas, il s’agit d’une projection chimérique.

Copyr. Akihiko KONDO
LAQ : Ne reste-t-il plus rien des révoltes des années 60 et 70 qui remettaient le vivant et l’humain en première position dans la société pour lutter contre les restes du féodalisme nippon – et 30 d’occupation des USA ?
Agnès Giard : La tradition de dissidence du Japon s’est effectivement érodée après les soulèvements étudiants et paysans de 1967-1970 : les manifestations contre les bases militaires américaines ou contre l’aéroport de Narita ont été réprimées dans le sang mais surtout ont débouché sur des luttes intestines, suscitant une réaction de méfiance durable de la part du grand public. Organiser des émeutes ? Fomenter des coups d’état ? Militer en bloquant des routes ? Affronter des policiers ? Pour la plupart de mes interlocuteurs, ces formes de contestation, jugées trop brutales (ou trop frontales) ont fait la preuve de leur inefficacité. Ils et elles préfèrent les stratégies obliques, c’est-à-dire la mise en scène ostentatoire de ces « amours insensées » (je cite Tanizaki) comme moyen d’exprimer à la fois sa colère contre un système dysfonctionnel, sa frustration d’être laissé-pour compte, mais aussi le désir de changer le monde et l’espoir d’être heureux autrement. La pratique de l’amour dit 2D s’ancre dans la contre-culture et soude entre eux des millions de fans, unis par une forme d’amour qui relève clairement de la désobéissance civile. Bien qu’à nos yeux d’Occidentaux leur mouvement n’ait rien de très contestataire puisqu’il est non-violent, il faut pourtant se rendre à l’évidence : les fans s’engagent, à des degrés divers, dans des activités jugées déviantes, donc séditieuses. Les plus radicaux s’exposent à la mort sociale lorsqu’ils ou elles épousent un personnage. Bien que le phénomène soit maintenant récupéré sous le nom d’oshi-katsu, il reste très mal-vu : dans les médias, il n’est ainsi pas rare de lire des tribunes dénonçant la prétendue « aliénation » de cette jeunesse « hédoniste », « désaxée » ou « en perte de repères », désignée comme bouc émissaire à la vindicte publique. Ceux-celles qui se mobilisent autour de leurs amours manifestent en actes une véritable révolte puisqu’ils et elles refusent de « reproduire » les schémas.
LAQ : Tu parles d’un univers englobant anime, jeux vidéo, mode et réseaux, quels en sont les limites et comment les industriels proposent-ils des objets dérivatifs propres à cet univers sérié ?
Agnès Giard : Les personnages à aimer viennent du Media Mix, les contenus de divertissement qui se déploient sur tous les supports possibles : manga, jeux, albums pop, anime, spectacle musical, etc. Ce n’est pas innocent bien sûr. Le Media Mix entretient des affinités profondes avec ce système de croyance qui voit des êtres surnaturels circuler à travers toutes sortes d’interfaces. A l’instar de ces présences (esprits, défunts, dieux, âmes ou ombres), les personnages se matérialisent sous la forme d’images, de sons ou de couleurs, reproduites sur des badges, des mugs, des oreillers à étreindre, des posters, des cartes à collectionner, des accessoires de mode, des flacons de parfum, des bijoux, des boissons… Beaucoup de femmes, notamment, apparient leurs vêtements à ceux de leur chéri fictif afin d’intensifier le sentiment de proximité. Elles le portent à fleur de peau et soignent leur apparence afin d’attirer le regard : leur corps fournit la preuve tangible que le personnage existe, puisqu’il les rend belles. Comme on le voit, le mot « virtuel » est donc un peu désajusté. Les amours artificielles (appelons-les ainsi, par défaut) se manifestent de façon tangible pour pouvoir exister.

Copyr. Share Wedding
LAQ : Tu parles d’air amour- comme auparavant la culture rock avait inventé l’air guitar, est-ce un jeu avec le lieu ou avec le personnage et sa situation ?
Agnès Giard : L’expression « air amour » (ea ren’ai) désigne la façon dont les adeptes miment des échanges amoureux dans le vide. Cette expression a eu son heure de gloire car elle permettait aux fans de se désigner avec humour comme des performers travaillant sur l’invisible, c’est-à-dire sur les systèmes de représentation. Le mouvement de l’amour 2D est d’ailleurs très comparable à celui du Voguing : dans les deux cas, on a affaire à des personnes ostracisées qui « singent » les postures et les attitudes jugées désirables afin de saboter les normes de genre. Dans les deux cas, il s’agit de renvoyer au monde l’inanité des normes matrimoniales et sexuelles, leur côté fabriqué donc vain. L’amour 2D relève du théâtre et ses acteurs, qui reflètent en miroir le jeu des interactions sociales, en dévoile l’artifice. J’y vois là une forme subtile de dérision. Au Japon, les gens qui aiment des personnages fictifs ne le font généralement pas pour fuir la réalité. Ils se tournent vers le jeu comme vers une forme de magie opératoire.
LAQ : Comment en arrive-t-on à codifier des relations virtuelles jusqu’à des rites mortuaires ?
Agnès Giard : Beaucoup d’activités humaines supposent un jeu existentiel entre les valeurs du réel et de l’irréel : on se projette dans une fiction pour faire advenir quelque chose de « vrai ». On joue à être quelqu’un pour « devenir » ce quelqu’un. Tout jeu consiste à spéculer sur l'effet possible, dans le monde réel, de notre pouvoir d'imagination. En compagnie de leurs personnages bien-aimés, beaucoup d’humains s’amusent à réinventer un monde dans lequel il serait possible de vivre en couple sur d’autres bases que celles édictées par la société. Quand le personnage meurt, les humains organisent donc des cérémonies, calquées sur celles qui permettent de dire adieu à un proche : il y a des fleurs, des lettres de gratitude, parfois aussi des stèles mortuaires ou des cérémonies organisées dans des temples en présence de moines « réels » qui acceptent volontiers de se plier à ce jeu car les tenants du Bouddhisme savent bien que rien n’existe, sauf les désirs qui nous enchaînent au monde phénoménal.

Copyr. Sun Euro
LAQ : Ce qui me semble le plus loin de moi dans ton livre c’est la partie concernant les dépenses somptuaires qu’entraine cette virtualisation des relations ? Peux-tu développer ?
Agnès Giard : Au Japon, les pouvoirs publics ne soutiennent pas la production artistique. Les producteurs de manga, de jeu ou d’anime ne bénéficient pratiquement d’aucune aide et les fans en ont bien conscience : ils achètent donc autant qu’ils peuvent pour soutenir l’entreprise qui leur fournit du rêve, afin (disent-ils) de « prolonger la vie » de leur personnage bien-aimé. Ces dépenses sont d’ailleurs nommées « offrande » (o-fuse), pour en marquer le caractère sacrificiel. Il ne s’agit pas d’acquérir un bien pour augmenter son bien-être mais plutôt le contraire : il s’agit de se déposséder pour « soutenir » (ōen suru) une idole et lui « exprimer sa dévotion » (sōhai suru). L’émulation dans le milieu pousse d’ailleurs beaucoup de fans à dilapider leur argent : jetant leurs économies par la fenêtre, les plus radicales des amoureuses se privent et parfois s’endettent parce que le but, disent-elles, est de tout « brûler », brûler d’amour bien sûr. Profondément subversive, cette pratique s’inscrit à rebours des valeurs propres aux sociétés modernes qui prônent la sécurité, l’épargne, la transmission du patrimoine ou le confort matériel…
Le problème, bien sûr, c’est que l’achat de goodies et autres nourrit une industrie bien réelle. Certaines firmes incitent les fans à « crier leur amour » (ai wo sakebi), suivant la formule consacrée, c'est-à-dire à dépenser leur salaires en produits dérivés. Mettant « à profit » les offrandes qu'elles convertissent en gestes d'achat, ces firmes exploitent la logique d’holocauste des fans qui font maintenant l’objet d’études marketing. Les voilà quantifiés, profilés, ramenés au statut de simples « cibles marché », pour ne pas dire de moutons à tondre… Certains y voient une source de légitimité car, d’une certaine manière, leurs amours obtiennent ainsi le droit à l’existence. D'autres s'insurgent contre cette récupération. Signe des temps : la pratique des « amours fictives» (nijigen ren’ai) a, depuis la pandémie, été requalifiée de « vie avec le favori » (oshi-katsu) à l’aide d’un mot-parapluie bien pratique, contribuant d'une part à banaliser l'existence des amours artificielles, d'autre part à en atténuer la charge de sédition.

Copyr. Yupiteru.
LAQ : Et, pour ne pas oublier ton dernier chapitre, comment formuler l’au-delà à partir du virtuel ?
Agnès Giard : Le bonheur à deux relevant du rêve impossible, une frange marginalisée de la population voue aux êtres fictifs l'équivalent d'un culte. C’est un culte pour rire bien sûr, dans le sens que les fans détournent sciemment le vocabulaire et les rituels de religions instituées pour en faire les instruments d’un jeu. Il s’agit de faire « comme si » les personnages (de mangas, jeux ou anime) étaient des « dieux » (kami) en leur vouant des « autels » (saidan) ou en effectuant des « pèlerinages » (junrei). Les quartiers dédiés au Media Mix sont appelés des « sanctuaires » (seichi) car c’est là que s’achètent ou se troquent les icônes saintes, c’est-à-dire les goodies. Les auto-proclamés « croyants » (shinja) se reconnaissent aux « talismans » (o-mamori) qu’ils accrochent à leurs smartphone. A Ikebukuro, quartier dédié aux adeptes de « beaux gosses » (ikemen) portent à l’épaule un autel portatif appelé « sac de douleur » (ita-bag) car il est recouvert de badges et de peluches à l’image de leur bien-aimé. Ces sacs permettent aux femmes de communier dans l’amour pour le même contenu. Des ouvrages permettant de « prêcher » (fukyō) en faveur de l’amour 2D sont en vente dans ces quartiers peuplés de fans qui se désignent parfois avec humour comme des « missionnaires » (nekyūsha)… Le but du jeu est de « faire descendre sur terre » ces êtres désignés comme « venus d’une autre dimension » (jigen wo koete), en lui offrant son propre corps au besoin. Certains fans pratiquent d’ailleurs le cosplay ou son équivalent extrême, le kigurumi, afin d’accueillir en eux la présence de l’être chéri en lequel ils se dédoublent. Forts de cet amour, ils affrontent maintenant l’opinion publique, s’affichent, créent des associations et proposent, via les contenus auxquels ils collaborent, de nouveaux standards de vie à deux. Ils font de l’entrisme : une stratégie empruntée à Gramsci ?
———-
Outro de l’interviewer : Mon sentiment, après la lecture du livre et l’interview ci dessus est que là où on pensait avoir à faire à un simple phénomène de mode, on s’aperçoit en fait que cela a plus à voir avec une révolte hors norme et une pratique qui remet en jeu la simple place de l’être au sein de la société. Avec le corollaire que c’est une pratique qui se recentre sur l’individu là où la société japonaise ne propose rien qui soit en relation avec un quelconque désir personnel dans un monde dont le modèle s’effondre.
Propos recueillis par Jean-Pierre Simard, le 16/11/2025
Agnès Giard - Les amours artificielles au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires. Editions Albin Michel
17.11.2025 à 10:58
Les portraits gravés de Vhils, monuments du quotidien, font face aux pyramides de Gizeh.
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1397 mots)
L'idée poétique selon laquelle « les portes sont l'architecture de l'intimité » est à la base d'une nouvelle installation de l'artiste portugais Alexandre Farto, alias Vhils. Avec pour toile de fond le désert époustouflant des pyramides de Gizeh, « Doors of Cairo » est une œuvre spécifique au site qui présente une collection stratifiée des portraits gravés caractéristiques de l’artiste.

Des visages y apparaissent à travers les structures érodées, certaines nichées dans le sable, d'autres surplombant les échafaudages. En opposant les tombes anciennes à une installation qui ne ponctuera le paysage que pendant un mois, Vhils explore les façons dont nous marquons le monde et dont nos empreintes perdurent dans le temps. « Les pyramides ont été construites pour les rois et les dieux, destinées à durer éternellement. Mon installation est faite de bois et de mémoire, et elle disparaîtra bientôt », dit-il. « Pourtant, les deux appartiennent à la même impulsion humaine, celle de construire, de se souvenir, de laisser une trace. »

« Doors of Cairo » fait partie du cinquième projet Forever Is Now, une exposition permanente organisée par Art D'Égypte avec le soutien de l'UNESCO. Vhils est le premier artiste portugais invité à participer au projet, et il relie son pays natal à ce site historique. Les 65 portes réutilisées proviennent de chantiers de démolition et de rénovation dans les deux pays, et chacune porte les traces de son utilisation antérieure, qu'il s'agisse de peinture écaillée, de surfaces rayées ou d'empreintes digitales effacées qui subsistent à un endroit très usé.
Les portraits fragmentés ne représentent personne en particulier, mais servent plutôt de substituts aux personnes du passé et du présent. « Un seul visage peut représenter une personne, mais il peut aussi symboliser une communauté, une génération ou un paysage émotionnel commun », explique l'artiste. « Il montre à quel point les personnes et les lieux sont indissociables, comment la mémoire s'incruste dans la matière et comment l'identité se construit à partir de nombreuses couches invisibles. »
Après six mois passés à sculpter dans son atelier et à créer une version sculpturale plus petite qui survivra à l'installation extérieure, Vhils a passé trois jours à travailler sur place, façonnant et remodelant la composition. « Elle a évolué intuitivement, porte après porte, guidée par leur taille, leur texture et leur rythme », explique-t-il. « Ce projet est un dialogue entre le quotidien et l'éternel, entre les portes en bois de la vie ordinaire et les pyramides de pierre qui ont survécu aux civilisations. Il nous rappelle que même ce qui est temporaire peut porter le poids du temps. »
Doors of Cairo est exposée jusqu'au 7 décembre. Pour en savoir plus sur l'artiste, rendez-vous sur Instagram.
Jeannot Siris, le 189/11/2025
Vhils - Doors of Cairo -> 7/12/2025

17.11.2025 à 10:35
George Rouy envahit Boisgeloup avec ses spectres
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1970 mots)
Almine Rech présente l’exposition Shadowing de George Rouy visible dans l’atelier de sculpture de Pablo Picasso au Château de Boisgeloup. George Rouy est reconnu comme une figure de proue d’une nouvelle génération d’artistes. Son usage dynamique et singulier de la figure humaine, traversée par le désir, la liberté, l’aliénation et la crise, reflète les extrêmes de notre époque.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur
Les corps, saisis seuls, rassemblés en groupes silencieux ou emprisonnés dans des foules d’énergie informe, oscillent entre absorption et tension, entre immobilité et force expansive. Ensemble, ils composent des explorations lyriques de la masse, du mouvement et de l’identité dans un XXIe siècle globalisé et dominé par la technologie, évoquant les thèmes récurrents de la figure et du fantôme, du paysage et de l’anatomie, du visage et du masque. Ce langage corporel audacieux et subversif capture la tragique beauté et la transformation perpétuelle de notre présent.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur
Déployant un vocabulaire pictural aussi distinctif que viscéral, les œuvres de Rouy sont définies par les contradictions : stase et flux, précision et indétermination, chaos et harmonie. on œuvre constitue une exploration continue du corps envisagé comme un paysage, une déconstruction permanente de l’image vers une expression du corps humain en devenir, reconstruction et reformation. Son langage pictural embrasse à la fois une figuration extrême et une abstraction pure pour saisir les métamorphoses incessantes du corps dans notre contemporanéité. L’artiste remet en question la perception du corps comme entité fixe, lui préférant une vision du corps qu’il décrit comme « en guerre contre lui-même », se redéfinissant sans cesse dans sa relation à soi, aux autres et au monde.

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur
Depuis sa sortie du Camberwell College of Arts en 2016, Rouy a exposé à l’international, notamment dans Copistes, exposition collaborative entre le Musée du Louvre et le Centre Pompidou-Metz, Paris, France (2025–2026), States of Being, Société, Berlin, Allemagne (2025), Visions of the World, Kampa Museum, Prague, République tchèque (2025), The Bleed, Part II, Hauser & Wirth Downtown Los Angeles, États-Unis (2025), The Bleed, Part I, Hauser & Wirth London, Royaume-Uni (2024), Present Tense, Hauser & Wirth Somerset, Royaume-Uni (2024), The Echo of Picasso, Museo Picasso Málaga, Espagne (2023), Endless Song, Nicola Vassell Gallery, New York, États-Unis (2023), BODYSUIT, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2023), Belly Ache, Almine Rech, Paris, France (2022), Real Corporeal, Gladstone Gallery, New York, États-Unis (2022), A Thing for the Mind, Timothy Taylor Gallery, Londres, Royaume-Uni (2022), Shit Mirror, Peres Projects, Berlin, Allemagne (2022), Rested, Nicola Vassell, New York, États-Unis (2021–2022), Clot, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2020), Squeeze Hard Enough It Might Just Pop!, Hannah Barry Gallery, Londres, Royaume-Uni (2018). Ses œuvres figurent dans les collections du SFMoMA (San Francisco), du LACMA (Los Angeles), du Phoenix Art Museum (Phoenix), du Berkeley Museum of Art (Californie), de l’Institute of Contemporary Arts (Miami), de la Fondation Cartier pour l’art contemporain (Paris), de l’ALBERTINA Museum et de l’Albertina Modern (Vienne), de la Stahl Collection (Norrköping), du M Woods et du X Museum (Pékin), ainsi que du Sifang Art Museum (Nankin). Sa création scénique « BODYSUIT », réalisée avec la chorégraphe Sharon Eyal, incluait une musique originale composée par Rouy et a été présentée pour la première fois à Londres en 2023. L’œuvre a ensuite été réinventée en 2024 avec une nouvelle chorégraphie et un nouvel arrangement musical pour une version étendue, dont la première mondiale a eu lieu au Wapping Power Station (Londres) et à Hauser & Wirth Downtown Los Angeles en 2025. Sa première monographie, George Rouy: Selected Works 2017–2023, comprenant un texte de Charlie Mills, a été publié par Tarmac Press en 2023.
La Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso soutient les expositions organisées au Château de Boisgeloup. L’exposition bénéficie du soutien d’Almine Rech, de la Hannah Barry Gallery et de Hauser & Wirth.
William Willson, le 18/11/2025
George Rouy - Shadowing - > 23/11/2025
Château de Boisgeloup - 2, Rue du Chêne d’Huy 27140 Gisors

Vue d’installation de George Rouy, Shadowing, Château de Boisgeloup, Gisors, 2025 © George Rouy — Courtesy de l’artiste, Almine Rech, Hannah Barry Gallery & Hauser and Wirth — Photo : Nicolas Brasseur
17.11.2025 à 10:24
Le somptueux démontage de la machine à féminicide recompensé du prix Wepler
L'Autre Quotidien

Texte intégral (4255 mots)
Un grand Boum : le fait divers mis à nu par ses aposiopèses, même.
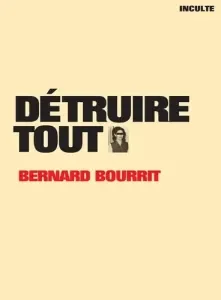
assurément il est tentant, afin de pondérer l’impatience, la curiosité, qui ne manque pas – tentant de commencer par établir les faits, ainsi qu’ils se sont enchaînés, et cela se soutient d’un point de vue journalistique, voulant pour comprendre reconstituer la chronologie des événements, alors on dirait ceci – dans la nuit du 4 juin 1967, après s’être rendu au domicile de sa victime, à Orsonne, Alain fit exploser une charge de cinq kilos de plastic, qui non seulement souffla l’immeuble où – mais aussi tragiquement causa la mort de Carmen, sa fiancée, âgée de seulement – et disant cela, nous n’y comprenons rien, à peine satisfaisons-nous la pulsion de terreur, en nous, qui veut voir – pour jouer avec le feu, et cela seulement qui fait divers/ion.
à la mode de Fénéon : à Orsonne, un jaloux, le jeune forestier Alain, pulvérisa d’une charge de TNT son amante, la couturière Carmen. – Jaloux comme un tigre, le manœuvre Alain, de Brovaz, fit sauter Mlle Carmen, croyant qu’elle avait quelqu’un dans son intimité, etc.
incidemment, tu auras compris que ce n’est pas de cette sorte et sous cet angle qu’apparaîtront les fantômes de jadis, et si l’un a survécu à son propre fantôme, l’autre n’est plus, et cela aussi constitue un écueil impossible à contourner (toujours les morts demandent réparation, tandis que les coupables -), mais justement, il ne s’agit plus d’appliquer le droit ou de le renverser, pas plus que de faire entendre – mais considérant le seul bloc de femme et d’homme ennemis qu’ils furent, considérant cela, l’arène où s’affrontèrent leurs désirs, et d’où tout autre chose aurait pu –
et réfléchissant à ce qu’il était en train d’écrire, il effaça le mot arène qu’il jugea suranné, et ne le remplaça par rien, suspendu à l’indécision de ce flottement, et se leva sèchement en fermant le capot de son ordinateur.
Si le fait divers, en tant que (trop fréquemment) « seul » témoignage de l’attention portée par la sphère médiatique aux affaires de police et de justice, sert surtout à faire diversion, selon la célèbre formule de Pierre Bourdieu (« Sur la télévision », 1996), il peut aussi, si l’on dépasse l’approche principalement sémiotique et esthétique de Roland Barthes (« Structure du fait divers », 1964) pour se rapprocher de celle – sociologique, philosophique et sainement marxisante – d’un Siegfried Kracauer (« Sous la surface », dans « Politique au jour le jour, 1930-1933 » – en fin de lecture, on se dira que son « L’ornement de la masse » de 1963 n’est pas nécessairement si loin ici), constituer un formidable vecteur d’investigation des vrais et faux déterminismes, des hasards comme des nécessités, et de tout ce que la société inflige au réel, et plus encore de ce que le récit dominant sait omettre. C’est ce défi que réalise, sous nos yeux d’abord légèrement incrédules, ce « Détruire tout », premier récit de Bernard Bourrit, déjà auteur d’essais sur Fautrier ou sur Montaigne, texte de 180 pages judicieusement illustré (on y reviendra), publié chez Inculte en septembre 2025.
En s’emparant de l’histoire d’Alain, qui assassina (à l’explosif militaire dérobé dans un dépôt voisin, excusez du peu) sa petite amie Carmen dans un village suisse, en 1967, Bernard Bourrit ne refuse pas l’obstacle d’une navigation au plus près entre un coupable simplement manipulé par sa propre histoire et son environnement et un coupable déjà psychopathe (l’auteur nous rappelle que le « concept » commence à émerger ces années-là – il n’existait pas, par exemple, à l’époque du « Un roi sans divertissement » de Jean Giono) dont la noirceur intérieure serait la seule en cause. Mais il se dégage tout au long de l’ouvrage de ce double bind, et saisissant les faits et leur matérialité en anti-psychiatre inspiré, il dresse un redoutable portrait détaillé de ce qui put ainsi « faire l’époque ».
Utilisant des sentiers fort différents de ceux empruntés tout récemment aussi par le Gilles Marchand des « Promesses orphelines », il traque dans les Trente Glorieuses, appliquées à cette Suisse semi-rurale, aussi bien le relativement peu perceptible (alors) et totalement terrifiant (avec du recul historique) processus qui associe extractivisme, productivisme et consumérisme à outrance, d’une part, et chosification, marchandisation et contractualisation généralisées, d’autre part. Convoquant lorsque nécessaire les révoltes paysannes qui n’ont alors rien de moyenâgeux, bien au contraire, l’enrégimentement médical et le remplacement définitif de l’échange par la monnaie, tels que les note alors Ivan Illich, les techniques fascisantes subrepticement à l’œuvre pour façonner le consensus d’opinion, les fantasmes économiques, sociaux et virilistes autour de la figure de l’immigré, et – déjà – la pression constante de la dette et de la rigueur sociale qu’elle suppose (en un torrent encore discret qui anticipe de plus de cinquante ans le fleuve majestueux dont Sandra Lucbert, par exemple, fera le récit ramassé dans son « Ministère des contes publics » de 2021), Bernard Bourrit nous offre, comme vademecum ou comme précieux à-côté de son investigation policière, judiciaire et médiatique, un extraordinaire condensé (ou un carrefour maléfique) de tout ce qui domine le conscient et l’inconscient de la société – mettons, suisse – de l’époque – et de la série d’ombres lourdes qui s’en trouvent ainsi portées jusqu’à aujourd’hui inclus.

« envoyé », « cure » – voilà des mots qui sonnent presque doux, paraissent anodins, qui ne le sont pas, car l’établissement de la Sapinière – encore un lieu-dit où le paysage vient s’encroûter sur le nom – vois – vois ces rangs d’épicéas noirs et raides dans l’hiver avec leurs pives écailleuses, pendantes, telles de sinistres quenouilles – la Sapinière est rattachée à l’établissement de Bellechasse, ce lieu semi-ouvert où s’appliquent les peines privatives de libertés, la prison où finira Alain – et, donc, la Sapinière est un endroit pour hommes où l’on interne, contre leur gré, les alcooliques, un établissement pour biberonneurs, comme on dit parfois, avec un vif dédain, un centre de détention pour qui trouble, par ses scandales répétés et vociférations, la paix publique – ivrognes, vagabonds, déviants, etc. – et que les lois sur l’assistance nomment, de façon générique, les « indigents ».
« des corridors spacieux, bien éclairés, nets comme dans un pensionnat de jeunes filles, une cuisine équipée à l’américaine avec des installations sans luxe, mais parfaitement étudiées, un réfectoire plaisant, une bibliothèque, une infirmerie meublée de lits tubulaires, où flotte une odeur médicamenteuse, et puis des dortoirs aérés, où règne un ordre parfait, dont la rigueur est tempérée par des bouquets disposés ici ou là – des pensionnaires ont fleuri leur table de nuit de marguerites et de pois de senteur, certains y ont apporté des postes de radio à galène, quelques photos évoquent affections amours regrets – » (il cite)
« ah ! puissance de régénération du travail en plein air. thérapeutique qui s’accompagne d’une hygiène rigoureuse, de recréations fatigantes au sein d’une atmosphère faite de confiance, d’ouverture maximum, sans surveillance tracassière – » (il cite)
ceux qui reviennent de la Sapinière s’extasient : j’ai passé ces derniers mois à « Nice » (il cite).
un rêve.
bien moins onirique la vérité puisque, généralement, c’est sur la dénonciation d’un voisin, au curé du village, ou à l’instituteur, que s’ouvre la procédure d’internement administratif – le syndic de la commune, soit le maire, sans nécessité d’en débattre avec son conseil, transmet le nom soufflé de l’indigent au préfet du district, lequel alors, seul, en âme et conscience, quoique, pour la conscience, s’autorisant des lois sur l’assistance, prend la décision, parfois, mais non toujours, sous la forme écrite d’une note, de faire interner pour une durée de – d’un mois à trois ans renouvelables, l’incorrigible, dont le nom a été soufflé par le voisin, amplifié par le curé, ou l’instituteur, approuvé par le syndic, et c’est ainsi qu’un jour, un encadrement policier, soit des agents de l’ordre assermentés, autorisés à faire usage de la force, se présentent au domicile dudit, qui est emmené sous les yeux de – et son exploitation brusquement laissée aux bons soins de sa famille, de ses frères, de sa femme et de ses enfants.
car l’aide sociale relève de la compétence exclusive des communes (donc, en dernier ressort, des voisins) – le syndic cumulant les fonctions décisionnelle et exécutive – et note bien que c’est, à propos de faits ne relevant pas d’une catégorie criminelle, une mesure pénale appliquée sans procès ni possibilité de recours.
et pour contourner les épisodes de delirium tremens provoqués par le sevrage sévère, l’établissement de la Sapinière vendait ouvertement la boisson dont le buveur chronique était censé s’abstenir, indiquant par-là que la finalité du lieu était, évidemment, la détention et la sédentarisation par le travail, l’assainissement de l’espace public, non le relèvement des ivrognes – méritant alors amplement son nom de « colonie pénitentiaire agricole » (il cite).

L’exercice à la fois tourbillonnant et méticuleux auquel se livre devant nous Bernard Bourrit aurait pu naturellement échouer (on trouvera d’ailleurs une superbe suggestion beckettienne à la page 158) face à l’ampleur fastidieuse d’une telle reconstruction ex post : sa réussite est au contraire flamboyante, ne serait-ce que par la grâce de la langue ad hoc que l’auteur a su imaginer pour l’occasion.
Là où un Philippe Jaenada, pour traiter ses propres cold cases (dans « La petite femelle » ou dans « La serpe »), utilise ses propres armes, à base de réjouissantes parenthèses et de digressions signifiantes, l’auteur vivant à Genève (et ayant su absorber au moment juste idoine certaines échappées langagières dignes d’un Arno Camenisch) a poussé dans ses retranchements, et à l’échelle d’un récit entier, l’usage déterminé de l’aposiopèse, cette manière stylée d’interrompre les phrases pour laisser la lectrice ou le lecteur les compléter in petto, que ce soit d’une évidence partagée et donc inutile à énoncer ou d’un saut imaginatif qui ne saurait être que strictement personnel, amplifiant magnifiquement l’intuition sublime du « La femme d’un homme qui » (2009) de Nick Barlay.
En rehaussant encore cet art de l’ellipse par le croisement de la mécanique de tutoiement du même ouvrage (celui de Nick Barlay) avec celle du Jean-Charles Massera de « United Emmerdements of New Order » (qui se passait, tiens donc, aux frontières… suisses), et en y ajoutant une extraordinaire hybridation de ce que nous appelions (plus ou moins) un embedded making-of chez le Mathieu Larnaudie des « Effondrés » et de ce que le grand Gabriel Josipovici sait mettre en œuvre comme en se jouant pour maintenir une distance salutaire et subtile entre le narrateur et l’objet de la narration (et ici, un laconique « il cite », par exemple, remplacerait le magique « dit-il » de l’auteur anglo-égyptien), on obtient bien la transformation de toute éventuelle leçon de police ou leçon de journalisme (qui seraient bien ironiquement présentes dans ce « Détruire tout ») en un véritable chef-d’œuvre.
principe et ligne rouge : exclure tout recours au témoignage de l’assassin vivant.
tandis que les murs d’était sont maçonnés, la façade principale de la ferme est tapissée de planches, épaisses et irrégulières, ayant pris, à cause des ans, cette nuance sombre qu’arborent les bois des chalets, la porte est basse, l’huisserie épaisse, les fenêtres étroites, vert forêt, à croisillons, et les volets ajourés d’un cœur – selon le goût local, les ouvertures s’ornent de nombreuses suspensions desquelles retombent d’opulentes gerbes de géraniums roses, où l’on pique à l’approche de la fête nationale des fanions, décorés de la croix fédérale – mais on remarque également, discrets, à l’angle, sous une auge taillée dans un fût soigneusement évidé, plusieurs nains de jardin à chemise bleue et bonnet rouge – et le vélomoteur Pony 521 rouge écarlate, sur sa béquille.
a-t-il raison – raison de penser que cette contrée aux traditions ancestrales, à l’humeur grégaire, dont la vision fait nécessairement concevoir quantité de niaiseries au voyageur de passage – et sitôt s’interrompant, il songe que d’autres personnalités que celle d’Alain trouvèrent, sans difficulté particulière, à croître et prospérer dans ce cadre, à vivre dans ce tableau romantique – en apparence seulement – où le fait de nature incarne le fait de culture (bal, transhumance, vendanges) – ainsi p. ex. la famille de Carmen qui fut un modèle d’épanouissement, quoique travaillant, elle, pour les manufactures du cru, et songeant qu’il faudrait une grille plus fine pour appréhender les rivalités qui traversent un bourg de campagne comme Orsonne, où, dans les années 1960, par leurs privilèges, notables, patrons et banquiers cristallisent déjà le ressentiment des couches populaires, bien que, partageant avec elles, transversalement, ce trait d’époque – le paternalisme – cherchant, par ce terme, à désigner la manière dont les vieux (les pères) s’adressent aux jeunes, non en tant que jeunes, mais déjà en tant que vieux – le paternalisme étant l’idéologie par laquelle la vieille génération étouffe la nouvelle, les pères étouffant fils et filles, et les mères imitant fort bien les pères, enfin – a-t-il raison, donc, de penser que ce milieu-là, massivement caractérisé par l’étroitesse de vue de ses acteurs et l’absence de perspective, de penser que ce milieu engendre le désespoir, un désespoir si complet qu’il motive finalement le passage à l’acte, ou bien y a-t-il dès le commencement une particularité dans la personne d’Alain qui – reposons la question à moindres frais : est-ce le pays, la famille, qui furent fabrique de désespoir, ou bien Alain fut-il désespéré par sa propre faillite ? ou les deux ?
et si de la mère on ne sait rien, et si de l’enfance peu de choses (mais non rien), et qu’il fallait étayer l’enquête de quelques évidences, afin de donner ossature à cette cabane provisoire de mots qui s’échafaude à tâtons et se délie dans l’insignifiance, peut-être, s’il n’en fallait qu’une, choisirait-il cette coïncidence-là : le 29 décembre 1962, le Lux Cinéma projette à Orsonne un film d’aventures en couleurs Panavision – « Panavision », te souviens-tu de ce que c’est ? – un film, Le Robinson suisse, adaptant le roman de Wyss, adaptant lui-même le roman de Defoe, et, sans doute, comme l’indique l’affiche, est-ce un film enthousiasmant – « enthousiasmant jeunes et vieux » (il cite), au prix d’un franc cinquante la place, soit sept francs d’aujourd’hui, et il est en mesure d’affirmer que, malgré son goût avéré et connu pour le genre, pour ce genre de film, donc les films d’aventures, Alain alors âgé de quatorze ans, ce 29 décembre, n’assistera pas à la séance, non – violemment tombé en skiant la veille, peut-être l’avant-veille, il s’était rompu la jambe droite. […]
l’avocat de la défense, Gérard Vaudrozat, jugea significatif, assez pour être cité comme argument de défense, la présence exceptionnelle dans la chambre d’Alain de romans d’aventures et d’espionnage – et, dans l’esprit affreusement moral du défenseur, le romanesque figure le terrain pourri, le marécage, la cage, où se perd l’esprit de la jeunesse, faisant un lien direct, un uppercut, entre le coup lu et le coup donné, vieille histoire, comme si l’imaginaire était non libre – bref, au lieu de souligner, et, proprement, cela est extraordinaire, la présence de livres dans la chambre d’un fils d’agriculteur, Vaudrozat semble croire que la violence aurait eu pour origine un certain goût singulier, allez, une perversion, pour l’art et ses déports.
Hugues Charybde, le 18/11/2025
Bernard Bourrit - Détruire tout - éditions Inculte dernière marge
l’acheter chez Charybde, ici
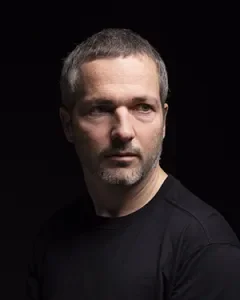
17.11.2025 à 09:50
Aurore Bagarry s'enroche à la côte chez Sit Down
L'Autre Quotidien

Texte intégral (3903 mots)
« Un saut dans le temps correspond au grand bond en avant vers l’ouest. De l’autre côté de l’Atlantique, les côtes martiniquaises et guadeloupéennes dégagent les roches volcaniques crachées il y a peu par la montagne Pelée et la Soufrière. Où l’on se rend compte que de part et d’autre de l’Océan, tous types de roches sont représentés, volcaniques ici, sédimentaires là, magmatiques et métamorphiques encore. L’Atlantique est un musée de géologie à ciel ouvert. » Philippe Bouvais.

Le travail photographique d’Aurore Bagarry est surprenant parce qu’il introduit une forme de présence au monde particulière, dans la lecture des formations géologiques et de leurs érosions, éléments bruts et sauvages des côtes bretonne, guadeloupéenne, martiniquaise, dans un temps géologique, hors de la juridiction des hommes, et pourtant témoignage avéré en raison du dérèglement climatique. L’exposition garde le même titre que le livre, il est question de la Côte, cette frontière entre terre et mer, océan, soumise aux flux marins, sculptées par les éléments, hier encore prévisibles, aujourd’hui aux épisodes plus extrêmes. Aurore Bagarry est à la fois cette photographe plasticienne géologue par la valeur des grands formats couleur exposés ici et une photographe documentaire scientifique qui donne à voir, sur la côte, les traces du littoral attaqué par les éléments plus agressifs que par le passé.
Les deux instances sont intriquées, elles donnent à ce travail toute sa valeur prédicative, informative, artistique; une vision s’en dégage, particulièrement sur un plan symbolique en « interrogeant » le regard, la vision sur la plasticité des roches dans leurs compositions, leurs stratifications, ce qu’elles sont géologiquement, et le renvoi plus poétique à cette dialectique de l’imagination matérielle, à l’interprétation de ce que génère ces matérialités différentes des strates et des blocs de roches photographiés in situ dans une approche plus onirique, dans une dynamique de la psyché et de ce qu’elle produit en chacun, comme ciel, comme rêve, à partir du « dur ».

Aurore BAGARRY nous offre par l’exposition à la galerie Sit Down, par ses grands formats parfaits, par le livre qui assemble ce travail, un voyage à travers le temps, des productions naturelles de la Nature en ces fragments côtiers à la possibilité des nuages, c’est à dire dialectiquement à la possibilité de l’imaginaire et du rêve.
A la lecture de ces grands formats, la rêverie intervient, l’image se charge des paysages photographiés pour parfois, et notamment avec le sable et ses concrétions, alimenter une rêverie propre aux éléments dans cette organisation quasi «naturelle», faisant référence, pour qui sait, aux amants de la Nature dont Novalis parle dans les Disciples de Saïs. Des correspondances s’annoncent dans un ciel interprétatif, bondissent aux portes de nos psychés, pour s’éprendre des preuves que la photographie d’Aurore Bagarry a durablement installé au sein de cette psychologie active, de cette rêverie, par le souvenir premier de ce que dit Baudelaire: » Plus la matière est en apparence, positive et solide, et plus la besogne de l’imagination est subtile et laborieuse… »
Que les rochers soient pour Novalis des images fondamentales « ainsi des enfants de la Nature: les rocs primordiaux; dit-il dans Henri d’Ofterdingen qu’Aurore Bagarry , rejetant tout artifice, tout spectacle, manifeste une volonté plus grande, sans doute d’établir des scènes primitives à rebours du visible dans l’invisible du temps qui a fait œuvre comme aussi celle d’animer toute l’âme par une volonté du voir… comment sortir de l’ambivalence des images, comment accéder à l’intimité du contraste, entre ce qui est dur et procède de l’Immémorial, ce temps où nous n’étions pas encore présent en tant qu’espèce, temps cellulaire pourtant conjointement, et l’objectivité de percevoir tout un langage des formes aussi primitives soient-elles, afin d’alimenter ce qui fait Art, ce qui s’articule dans l’énonciation de ces pierres à leur fantasque ossature et aux rêves qui s’en échappent, agrégats tout autant de cette part native de l’homme qui primitif, aux instincts aiguisés, à l’intelligence pratique universelle, ne devait cesser de rêver aux étoiles dans la profondeur protectrice des grottes, et à ce que les grottes aussi nous disposaient à rêver, dans leur protection, par la caverne enluminée, le gouffre domestiqué, la possibilité des fresques pariétales. Il me semble que tout un mouvement profond nidifié dans la roche et sur la terre des contrastes est ici photographié dans le même temps que ce que nous est montré plus objectivement par cette photographie.

Sensible métonymie amoureuse, asymptomatique et contagieuse, la volonté de voir de la photographe touche juste; ce relevé pur du paysage s’affirme dans un fragment de côte, en sa lumière naturelle comme un passage de relais entre deux états, œuvre de la Nature et œuvre d’Art, sur une frontière poreuse très séduisante. Il importe que nous ne sachions pas toujours d’où procède et où s’intrique le formidable travail du temps dans l’Immémorial, la jouissance de pouvoir sagement en lire, par l’œuvre encadrée, tout le champ de l’universel, en joue; une poétique du dynamisme psychologique en résulte… confondant, un voir qui préexistant au regard de cette situation paradoxale, fait saillir et jouir jouit le sens de ne pouvoir dé-mêler plus exactement ce qui nous met en mouvement entre ces deux polarités, ce qui nous intrigue en sollicitant ce vieux fond culturel des sciences exactes et rationnelles et cet imaginaire romantique qui n’a cessé d’exalter cet amour aimant de la Nature comme la preuve définitive du Principe Créateur. Ici un irrationnel est entré dans l’équation pour le plus grand bonheur de sa sollicitation féconde car il nous accorde le génie des substances et le dynamisme de ces rêves autour de la création.
Aurore Bagarry semble faire remonter son « voir » avant le Voir, dans l’Imaginaire et par la Science. Ces paysages fragmentaires, ces rochers, ces rivières de pierres, ces parois, ces cavernes, sont autant de propositions à rêver que de descriptions de la roche et de ses composantes. Elle nous convoque simplement à ses côtés dans un geste disant tu vois là, (respiration) tu vois…, ce geste suppose la culture des sédiments et la sensibilité des roches, rochers, parts du littoral. Sa photographie est au delà du documentaire, elle repose avant tout sur une volonté de voir, de rendre compte, de rapporter au devant d’elle même ces paysages, ces roches vieilles de millions d’années, dont la physionomie actuelle est l’artefact majeur du travail de sculpteur de la Nature. Le rocher que nous avons devant les yeux à la galerie est en tout point de vue le résultat et l’œuvre de l’érosion, du temps, de ce temps si lointain, si méconnaissable que la seule façon de l’appréhender est de le contempler ici et maintenant, dans cette forme rapportée dans ces photographies, parts de l’histoire de ce temps.
Quelles forces ont pu ainsi forger et dans quelles temporalités ces rochers, ont ils été arrachés aux parois, puis roulés, dans ce lit de rivières, notre imagination n’a de cesse d’investir fantasmatiquement l’aventure de ces paysages et de nous faire romancier, géologue, robinson comme si nous étions ce capitaine Smolett ou plus vernien ce Cyrus Smith, voulant établir une colonie modèle. Si cette fantasmatique peut entrer en action c’est à mon sens parce que les cadrages des photographies sont extrêmement rigoureux, qu’ils fixent le point de vue et le point de vue, comme en architecture, relève ici du point de vue géologique, tel qu’il parle de son histoire propre, et qu’il donne à l’Immémorial une forme et une matière, un lieu précis, issu des côtes du Finistère, Morbihan, Charente maritime, Guadeloupe…

Le texte signé Philippe Bouvais est particulièrement averti des compositions que la géologie a fait naitre aux différentes périodes de formation des côtes, cet énoncé scientifique permet de qualifier ces roches que seul ce vocabulaire est en droit de nommer justement, une poétique des matières vient faire jouer très agréablement d’autres références à la description des roches et gemmes, dans la constitution d’un paysage assez brut. Est expliqué ici géologiquement la formation des couches et la spécificité de celles-ci en lien avec les périodes du Crétacé, du Mézoïque, du Cambrien, du Jurassique…. Ce qui immédiatement fait retour sur ces fragments de Côte photographiés à la chambre et aux grands formats de l’exposition, à ce fascinum qui fait photographie et qui rend compte, qui situe, qui échappe, qui enchante et ensorcelle (sens primitif de fascinum)… c’est sans doute pourquoi le mouvement qui va des rochers à l’océan nous relie à cette poétique romantique et à la suggestion de l’air, du ciel, pour assumer le voyage aux roches coupantes, le voyage de la terre et des forces herculéennes qui échappent à la représentation mais qui supposent la connaissance et le voyage..
« Le Massif armoricain est constitué en grande partie, au moins dans sa partie méridionale, du Pouliguen à la pointe du Raz, de roches qui se sont formées au cœur de cette ancienne montagne. Et si ces roches plutoniques et métamorphiques affleurent aujourd’hui, c’est justement grâce à l’érosion, qui en a dégagé la couverture. À vrai dire, la mise à l’affleurement des roches armoricaines s’est faite bien avant les temps actuels. On pourrait croire que les roches armoricaines, granitiques ou métamorphiques, sont plus résistantes aux processus érosifs que les sables et calcaires aquitains et vendéens. Ce n’est pas vrai. La Côte sauvage de Quiberon en atteste. On y trouve de nombreuses grottes, à Port-Bara et à Port-Rhu, on y trouve des falaises morcelées, on y trouve des éboulements chaotiques. Bien sûr, d’une saison à l’autre le granite est plus résistant qu’une roche marneuse ou sableuse, mais à l’échelle de décennies le recul du trait de côte est comparable. Il ne procède simplement pas de la même cinétique. La marne s’érode continûment, un peu tous les jours, le trait de côte recule régulièrement ; le granite tient bon pendant des saisons, puis s’écroule brutalement, en blocs cyclopéens, le recul du trait de côte est brutal, et opère par à-coups. »
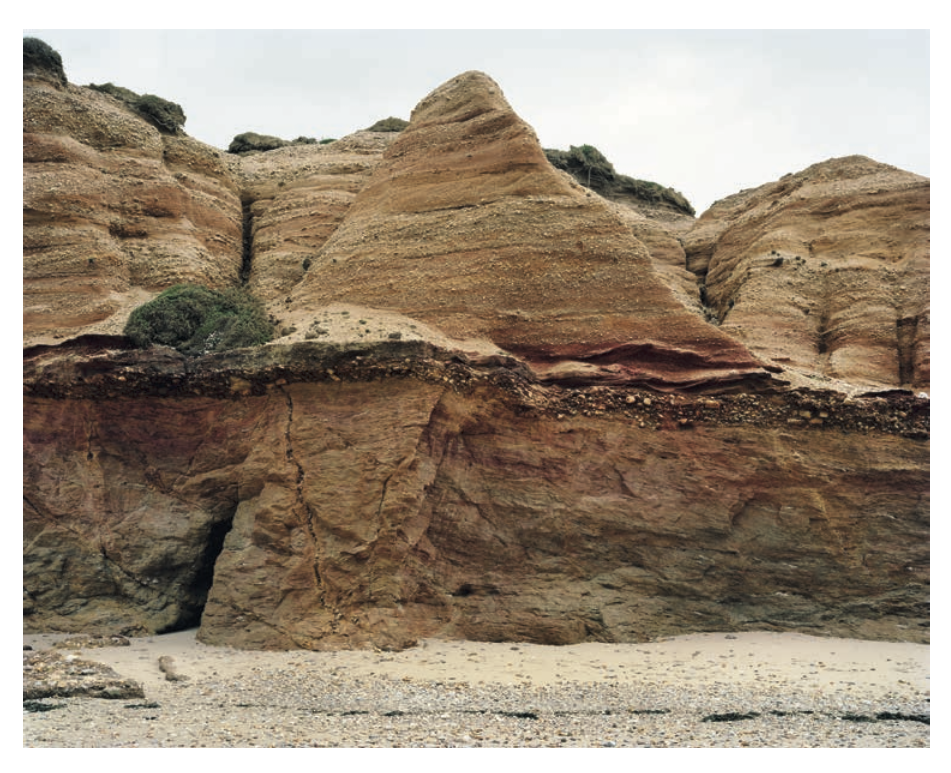
Série de la Côte, ©Aurore bagarry courtesy Galerie Sit Down.
Aurore bagarry de conclure:
“La roche m’évoque le “fragment hérisson“ de Friedrich Schlegel, et les écrits de Novalis, qui était aussi géologue et cosmologue. Elle est à la fois un monde en soi, un modèle réduit, sur lequel l’artiste fait évoluer son imagination. Clos sur lui même, isolé, le fragment a paradoxalement une puissante force d’évocation. Ainsi les formations ou curiosités géologiques suggèrent d’autres paysages lointains, présents sur d’autres continents. En jouant sur l’échelle, en cadrant sur certaines couleurs, je constitue un répertoire de formes de roches, pour laisser libre court à l’élaboration d’un paysage marin réel et imaginaire.“ Aurore Bagary
Pascal Therme, le 18/11/2025
Aurore Bagarry - De la côte -> 13/12/2025
Galerie Sit Down 4, rue Sainte-Anastase , 75003 Paris.
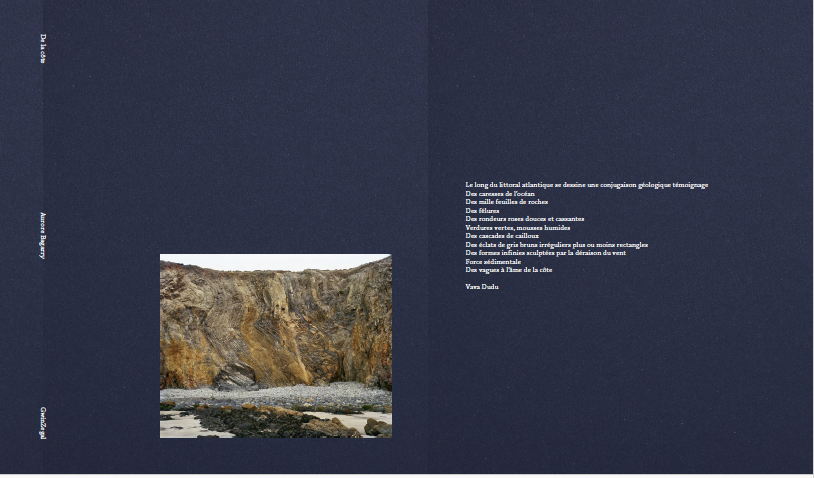
Résidence de recherche et création dans le Grand Ouest réalisée avec le soutien des Ateliers Médicis, la Fondation d’entreprise Neuflize OBC et la DRAC Bretagne.
12.11.2025 à 11:59
Inspirations #114
L'Autre Quotidien

Texte intégral (750 mots)

Ivan Kardashev - Matter and Time
L’air du temps
Kaleema - Nómada

Le haïku de tête
Je marche
dans un jardin de braises fraîches
sous leur abri de feuilles
un charbon ardent sur la bouche
Philippe Jaccottet
L'éternel proverbe
Le temps détruit tout ce qui est fait ; et la langue, tout ce qui est à faire.
Proverbe flamand
Les mots qui parlent
J'ai étouffé un cri, j'ai souhaité l'aide de Dieu,
je suis sorti en courant,
je suis revenu sur mes pas,
j'ai tourné en rond dans la chambre,
trop seul à aimer ou à ne plus aimer,
souffrant,
souffrant de l'insuffisance déplorable de mon être
à connaître cet événement.
Marguerite Duras, Le ravissement de Lol V. Stein

D. W. Griffith's The Musketeers of Pig Alley, 1912
11.11.2025 à 11:59
On aime #116
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1005 mots)
L’image 1

À travers des images saisissantes et saturées, Victoria Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Voir notre article.
L'image 2
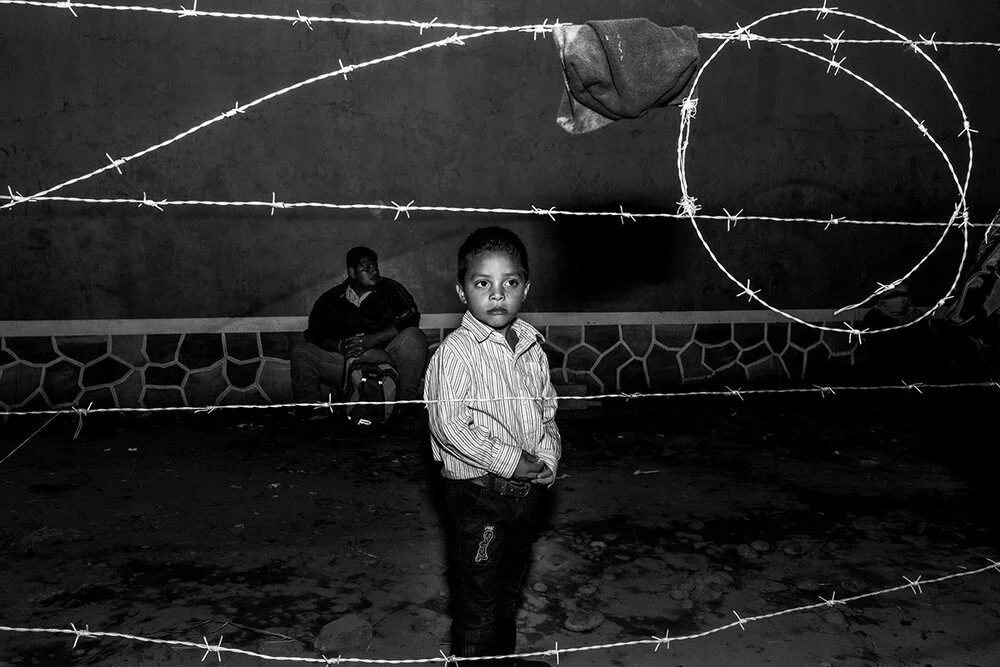
La Caravana Del Diablo by Ada Luisa Trillo. José, janvier 2020, Après avoir dormi dans un terrain vague près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, José, un enfant migrant de 6 ans voyageant avec son père depuis le Honduras, attend patiemment à 3 heures du matin pour recommencer son voyage et traverser la frontière vers le Mexique par la rivière Suchiate. Deux jours auparavant, la Caravane a tenté de traverser le territoire mexicain par la rivière Suchiate, et la Garde nationale mexicaine portant des fusils semi-automatiques s'est mobilisée, essayant de cibler les groupes et de détenir des personnes là où ils le pouvaient. Il y a eu des poussées et des luttes pour persuader les migrants de ne pas traverser illégalement. De nombreux migrants ont été appréhendés à la rivière ; d'autres, comme José et son père, se sont échappés.
L'air du temps
Tony Allen - One In A Million

Le haïku de dés
Dans mon bol de fer
En guise d’aumône
La grêle.
Taneda Santoka
L'éternel proverbe
Si travailler c’était bien, les riches travailleraient depuis longtemps. (Si travay té bon bagay, moun rich la pran’l lontan)
Proverbe haïtien
Les mots qui parlent
Celui qui écrit son histoire hérite la terre des mots.
Et possède le sens,
Entièrement.
Mahmoud Darwich
11.11.2025 à 09:55
Zulu Guitar blues, oui mais à part Ted !
L'Autre Quotidien
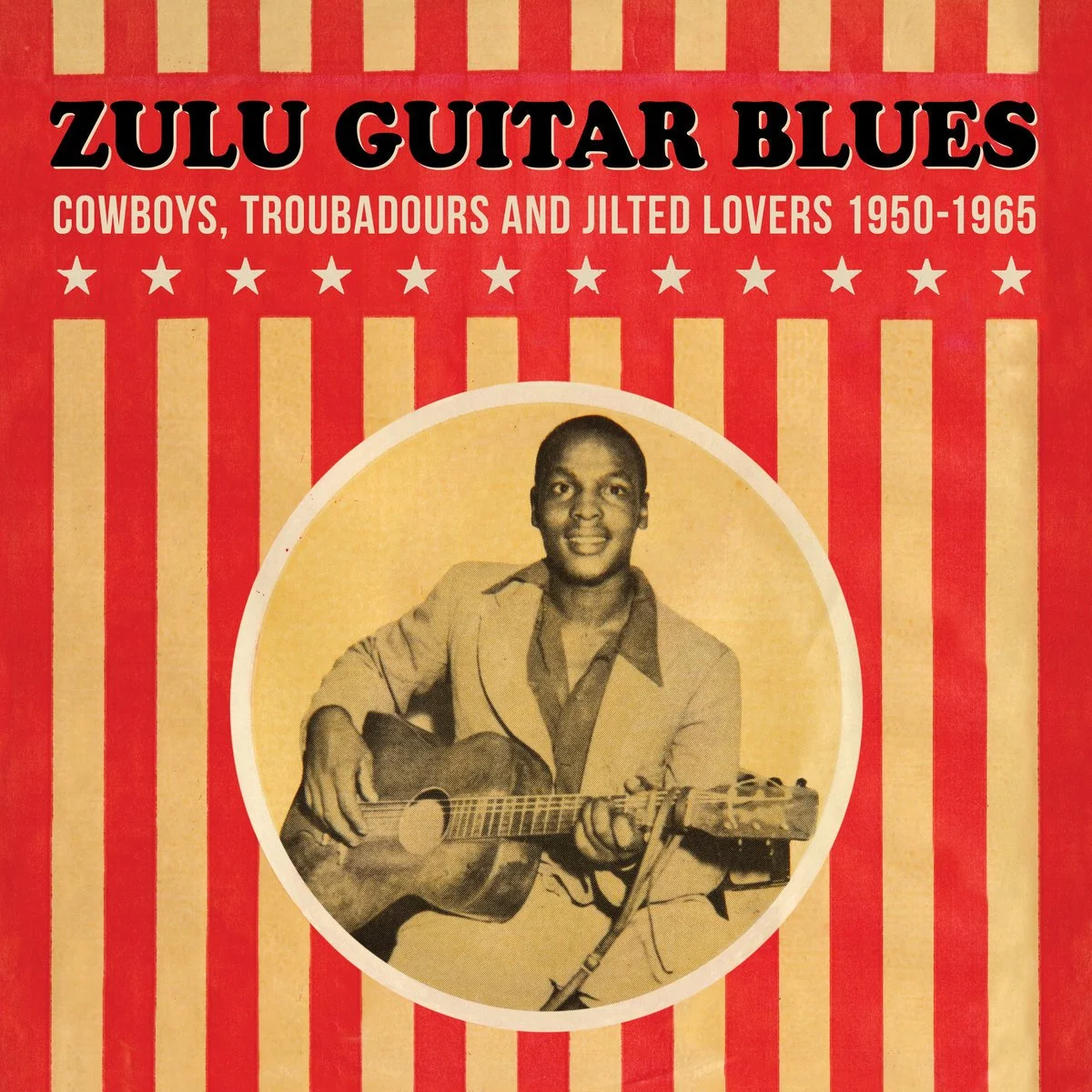
Texte intégral (807 mots)
Au moment où un tas de crétins issus des trois religions monothéistes voudraient vous seriner qu’en dehors d’eux - et une obéissance stricte à leurs desiderata passéistes - , votre vie n’a aucune autre valeur que celle qu’ils veulent bien leur attribuer ; il est temps de venir réécouter le blues de l’Afrique du Sud à l’heure de l’apartheid. Ce que cette compilation fournie du label Matsuli Music vous offre à grands coups de cordes souvent aigrelettes. Des histoires qui en racontent de toutes autres que celles audibles à la première écoute.
Sans cette compilation de chansons sauvées et magistralement restaurées à partir de rares disques 78 tours en gomme-laque, peu de gens pourraient imaginer la beauté et la diversité des racines de la musique zouloue à la guitare qui ont émergé entre 1950 et 1965. Des conteurs et des musiciens de talent s'approprient des personnages hors-la-loi, réutilisent la country, la musique western, hawaïenne et d'autres styles pour élargir et remettre en question notre conception de la « guitare zouloue ». A jouer pour déjouer le carcan.
Vingt-cinq chansons (18 sur vinyle) nous plongent dans les profondeurs de l'expérience des migrants. Les traductions dans les notes de pochette nous offrent un aperçu de la combativité, de la mélancolie et du chagrin, le tout teinté du paternalisme qui encadrait la vie des chanteurs sous le joug de l'apartheid.
Le courant sous-jacent du mbaqanga dans de nombreuses chansons subvertit l'esprit vagabond de la musique country et western en une fugacité chargée de nostalgie. Quelque chose d'irrémédiablement perdu a poussé à un mélange d'idées et de cultures pour donner un sens à travers des actes ingrats de divination musicale. Sans le vouloir, ils ont été propulsés dans le rôle d'anti-héros, où déjouer la concurrence pour les amants est aussi important que d'échapper aux Black Jacks (les policiers municipaux de l'apartheid) et à leurs informateurs. Un peu à la manière du “Dancin in the Streets” de Marvin Gaye chanté par Martha & the Vendellas, qui servait de bande son aux manifestations pour les droits civiques aux USA à la même période.
Compte tenu de la période de répression politique dont cette musique est issue, on peut supposer que la spécificité de la narration a largement contribué à échapper à la censure. Mais même lorsque les mots sont absents, l'expression musicale suggère un arc narratif.
La plupart des bandes originales ayant été délibérément détruites ou perdues, les techniques modernes de transcription et de restauration à partir des disques shellac originaux permettent de restituer le son original avec une clarté sans doute inégalée. Et comme il n’y pas de clips, on vous laisse juste avec le son; histoire de vous vous refaire vous-même l’histoire que voudrez poser sur ces sons. Enjoy !
Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025
Various Artists - Zulu Guitar Blues, Cowboys, Troubadours & Jilted Lovers - Matsuli Music
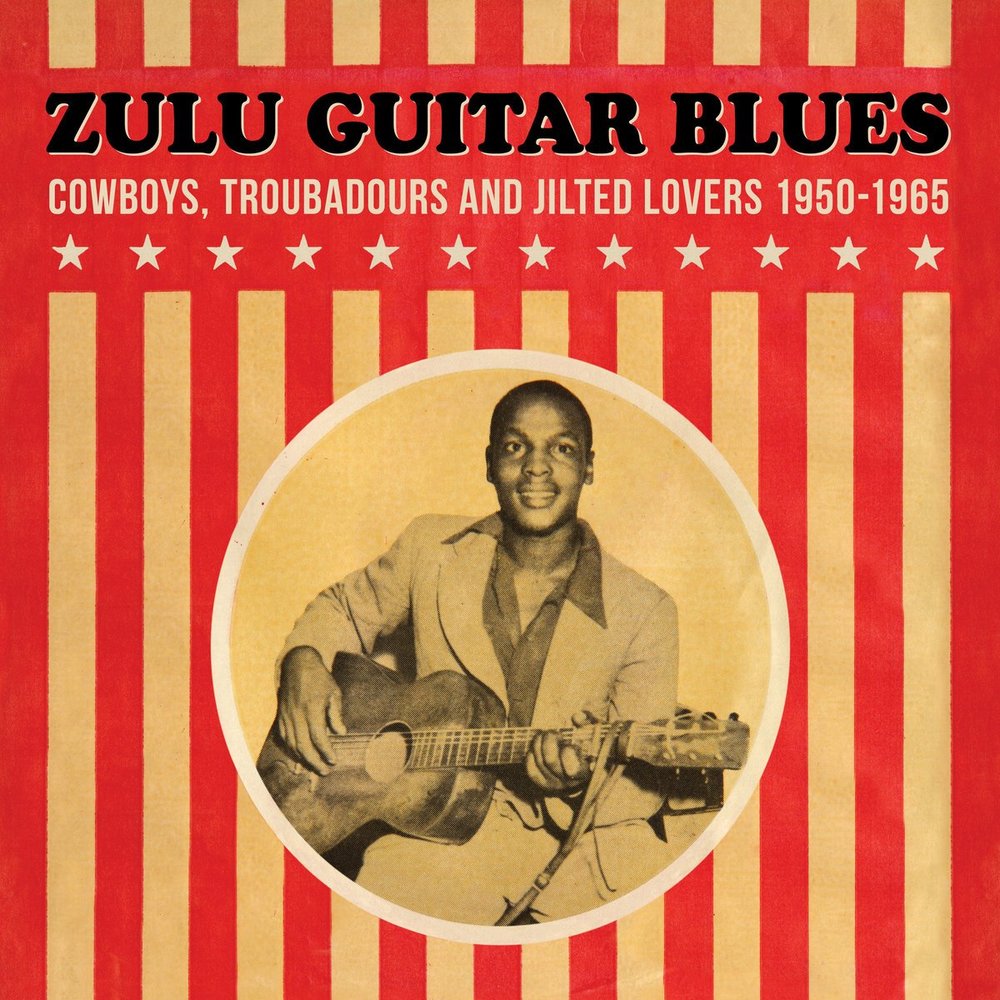
10.11.2025 à 19:52
Des flirts virtuels avec des fiancées imaginaires ou comment se vivent les amours artificiels au Japon par Agnès Giard
L'Autre Quotidien

Texte intégral (2672 mots)
Les partenaires artificiels sont-ils des «solutions innovantes» au «problème de la solitude» ? Alors que les technologies de l'empathie se développent (servies par un discours marketing fallacieux), le Japon se peuple de présences aimantes qui fournissent la matière d’un jeu à grande échelle. Ce jeu consiste à faire comme si les créatures imaginaires étaient non pas des instruments au service de l’humain mais des êtres surnaturels à chérir, voire à vénérer, afin que se manifeste leur puissance opérative. Comme le montre Agnès Giard, il s'agit de prendre au sérieux ce jeu qui, renversant le paradigme utilitariste, procède d'une volonté de «croire» en l'existence d'une dimension parallèle .

Les Amours artificielles au Japon
Au Japon, le nombre de mariages n’a jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contraste, un nombre croissant d'hommes et, surtout, de femmes se mettent en couple avec des partenaires fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel.
Comment comprendre ce phénomène ? Depuis l’explosion de la bulle économique dans les années 1990, il est devenu difficile de fonder un foyer. Acculées au célibat ou forcées de souscrire à un modèle matrimonial périmé, des millions de personnes tentent de trouver le bonheur dans les bras d’êtres venus de la « Deuxième Dimension » (ni-jigen), c’est-à-dire de la fiction. Le mouvement rassemble une frange croissante de la population qui, pour faire face au stigmate, détourne les rituels et le vocabulaire du sacré afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, collecte d’icônes, offrandes, funérailles : l’ouvrage se penche sur toutes les formes de religiosité développées au sein de cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur d’un phénomène aux allures d’holocauste symbolique.
Les nouvelles générations brûlent leur navire. Elles se vouent à l’amour pour les personnages, dans l'espoir non seulement d'atteindre le bonheur (même le plus illusoire en apparence) mais de changer le système en proposant, depuis les marges, des systèmes de valeur plus « désirables » et d'autres manières d'être au monde.

Pour matérialiser sa bien-aimée à taille humaine, Kondō Akihiko s’est procuré un corps de love doll et a fait faire une tête par un artiste spécialisé.
Ce livre porte sur les liens amoureux que des humains nouent avec des personnages.
Au Japon, un nombre croissant d’hommes et de femmes se mettent en couple avec des fiancées virtuelles ou des petits copains fictifs dans le cadre de mises en scène visant à brouiller les frontières qui séparent le jeu du réel. Le mouvement rassemble des gens qui, vivant seuls et sans enfants, sont jugés responsables de la dénatalité et, à terme, de l’effondrement du pays. On les accuse de causer de la chute à venir du système. Pour faire face au stigmate, cette frange de la population emprunte aux rituels religieux ses pratiques et son vocabulaire afin de rendre un culte aux personnages. Pèlerinages, cérémonies d’invocation, autels portatifs, adoration d’icônes, dépenses somptuaires nommées «offrandes», rituels de dévotion : l’ouvrage se penchera sur toutes les formes de religiosité développées par cette contre-culture, afin de révéler l’ampleur du phénomène mais surtout sa dimension quelque peu théâtrale d’holocauste symbolique.
Les nouvelles générations se vouent à l’amour pour les personnages, de façon spectaculaire (en se dépensant tout entières). A quoi bon faire des économies puisqu’on n’aura pas d’enfant ? Plutôt que de se battre pour un système qui dysfonctionne, la stratégie consiste à proposer, via les personnages, de nouveaux standards de vie à deux et de nouvelles formes de relation homme-femme.

L’artiste Wataboku met en scène une jeune fille nommée Sai, inventée sur le modèle de celle à qui, lycéen, il n’a jamais osé se déclarer.

Après cette introduction conséquente proposée par l’autrice (même) qui risque de vous ouvrir à des abîmes de perplexité, nous vous proposons de la retrouver en interview la semaine prochaine, pour tenter de comprendre ce que le virtuel peut avoir de tentant, comme paravent ou simulacre à la vie privée ( mais de quoi ? ) On vous laisse sur votre faim , et avec l’occasion de subir un vrai choc culturel. See ya next week !
Agnès Giard éditée par Jean-Pierre Simard, le 11/11/2025
Agnès Giard - Les amours artificiels au Japon, flirts virtuels et fiancées imaginaires - éditions Albin Michel

10.11.2025 à 18:47
Les contrastes de Photo Days 2025
L'Autre Quotidien

Texte intégral (7692 mots)
« Vous n’échapperez pas à la photo » est le slogan de l’édition 2025 de Photo Days en Novembre. Et, effectivement on y parcourra peut-être 88 expositions, 44 rendez-vous, 120 visites guidées et plus de 180 artistes exposés grâce à de nombreux partenaires, privés comme institutionnels.

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025
Emmanuelle de l’Ecotais, docteur en Histoire de l’art, spécialiste internationale de l’œuvre de Man Ray, secondée par une équipe conséquente dont Camille Gajate, dirige le festival Photo Days, depuis 2020, date de sa création. Le festival Photo Days fédère chaque année en novembre musées, institutions culturelles, galeries, fondations, foires et festivals.
On peut constater par l’usage des superlatifs employés que le festival se pense comme un agent puissant du paysage culturel actuel, toujours dynamique. C’est d’ailleurs ce que prouve cette 6e édition, qui s’adjoint six nouveaux lieux d’exposition, la Sorbonne Artgallery et la Rotonde Balzac de la Fondation des Artistes, le cinéma Le Louxor, le Studio Harcourt, la Chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière, et L’École des Arts Joailliers. Les valeurs du Festival sont en tout point dans le vent et remarquables, respect de la parité et mixité, défense de la scène artistique française, productions locales et écologiques, politique éditoriale soutenue par la fondation Antoine de Galber, nombre conséquent d’artistes exposés depuis sa création… dont Bernard Plossu, Jane & Louise Wilson, Anaïs Tondeur, Valérie Belin, Nancy Wilson-Pajic, Yann Toma, Georges Rousse, Véronique Ellena, Sophie Hatier, Juliette Agnel….
Tout le programme sur https://photodays.paris/
C’est le cas précisément pour cette sixième édition de, entre autres, Paolo Ventura, promenade de nuit à la Rotonde Balzac, Juliette Agnel, La susceptibilité des roches à l’école des Arts Joailliers, exposition qui se tient au Rez de chaussée de l’Hôtel de Mercy-Argenteau où se tient Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, dans une résonance revendiquée par les deux expositions, mais est-ce si certain?

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025

Rêveries de pierres: Poésie et minéraux de Roger Caillois, l’école des Arts Joailliers, Paris. photos ©PascalTherme2025
Exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois
À L’École des Arts Joailliers Hôtel de Mercy-Argenteau, Paris.
« L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois. L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits. » DP
Il m’ a semblé que les pierres dansaient dans les vitrines comme des objets célestes en orbite autour de cette terre que Roger Caillois célèbre comme cette Terre Mère, généreuse, terre du Vivant et dans cette expérience de lévitation, j’ai cru entendre lointainement cet écho du chant des pierres au creux de la terre, dans la lente progression du temps. Ouvrir les yeux, écouter, entendre, lire les mots de Caillois, pour découvrir qu’il s’agit tout autant ici, d’une exposition de minéraux, aussi magnifiques soient-ils que de la conversation audacieuse et singulière à laquelle Roger Caillois convie ses hôtes en les introduisant à cette poétique ensorcelante et lumineuse d’un émerveillement permanent dont cette collection est un témoignage précieux, un passage de témoin, une expérience au creux et au sein de la matière vivante.
Les Pierres et les mots, les idées, les concepts joueront donc à voyager au sein de cette intimité rêvée en laquelle se nidifie le rêve porté par ce chant des pierres aux noms des matières, agates, dendrites, pyrites, quartz, béryl, jaspes, aux noms de pays et d’histoire, pierre de Chine, pierres de l’antiquité, pierres du jardin cosmique. Nombreux seront les amateurs de pierres étranges, de pierres singulières, à pouvoir s’émerveiller des pierres qui enferment un secret aussi vieux que le temps et dont le visiteur est un dépositaire de quelques minutes, inversant ce ciel des comètes où se vit la trace de leur fulgurent passage. Ainsi se trouver en présence de ces pierres autorise à se plonger dans le miroir d’un temps géologique anti-historique, dans une appréhension de l’Immémorial et de trouver en ses formes particulières, en ses couleurs, en ses aspérités, tout un travail d’orfèvrerie réalisé par un temps qui échappe à la conscience et dont l’image est un oiseau au cœur battant qui dort au creux d’une montagne, dans sa fragilité poreuse et pourtant solide, en cette eau de la pierre qui éclaire et qui chante.



Encore faut-il pouvoir imager ce travail des millénaires, des millions d’années que ce bijou venu à paraitre au regard est enfin remonté des profondeurs, dans un voyage fait de pressions mécaniques, de chaleurs intenses, de purifications, d’anoblissements et de ferveurs, même si ces chants sous la lune sont parfois, dans certaines civilisations anciennes, un secret de la naissance du monde, une cosmogénèse, c’est-à-dire un univers évolutif et convergent, où Dieu se révèle d’abord comme l’avenir absolu, à travers un seuil d’extase; lire ici que la Nature est en tout point l’Origine et que les pierres semblent douées d’une vie propre, évolutive, qu’elles se réparent…tout au long de leur longue vie, qu’elles se transforment.
« Une sorte de réflexe pousse le savant à tenir pour sacrilège, pour scandaleux, pour délirant, de comparer, par exemple, la cicatrisation des tissus suivants et celle des cristaux. Cependant, il est de fait que les cristaux comme les organismes reconstitue, leur partie mutilées, accidentellement, et que la région lésée bénéficie d’un surcroît d’activité régénératrice, qui tend à compenser le dommage, le déséquilibre, la dissymétrie créé par la blessure.… Je sais, comme tout le monde, l’abîme, qui sépare la matière inerte de la matière vivante. Mais j’imagine aussi que l’une, et l’autre pourraient présenter des propriétés communes, tendant à rétablir l’intégrité de leurs structures, qu’il s’agisse de matière inerte ou vivante. » Cartouche de l’exposition.
Deux approches se dissocient sur la forme et sur le fond, partant de la même intention de rendre compte des correspondances entre certaines pierres, gemmes. Si l’écriture de Roger Caillois, ô combien étoilée, révèle ce que la psyché humaine doit au merveilleux de notre attachement au monde des pierres, l’inertie de l’imaginaire poétique se construisant dans une relation humaniste, l’exposition qui lui est consacrée, magnifique en donne et la preuve et la ferveur. Ici deux cent pierres et gemmes sélectionnées, dans une exposition didactique, poétique, formidable réjouissent le visiteur, devenu courtois compagnon de Caillois en son esprit libre et joaillier.
Portfolio édité https://pascaltherme.com/portfolio/roger-caillois



LA SUSCEPTIBILITÉ DES ROCHES PAR JULIETTE AGNEL
Juliette Agnel a choisi de faire tout autrement. Elle a privilégié de soumettre un corpus de dix sept gemmes à un dispositif photographique type studio photo , fond de même couleur bleu pétrole, lumière globale sans ombre, procédé uniformisant, sans visiblement établir une rêverie poétique issue de la vibration du secret et de l’invisible chant qui couronne la puissance tellurique, stellaire des pierres. Un silence se fait , là, où tout est tu.
Dans cette imparité de traitements, dont l’absence de coupe des pierres à la susceptibilité dormante, comment révéler cette présence de l’invisible, pourtant fondamentale à en croire le texte de présentation de l’exposition, qui revendique un acte qui n’a pas lieu réellement, laisser le cœur écouter les palpitations du temps qui s’égraine dans la pierre, pouvoir y lire pourquoi cette ligne blanche, fortifie t -elle cette couronne noire par la veine ainsi échue dans la pierre même, tout chemin d’abondance faisant lectures des courses, des lignes aimantes, séduisantes, dans l’inertie du rêve habile à les porter. (description d’une coupe de pierre de Caillois) Le rêve habile est pénétrant, il voit le chemin du monde, il est aimant, amant, aimanté; le regard butte, la pierre reste opaque, le mystère n’est plus!
Ne fallait-il pas alors prendre avec soi, le secret en motif pour écouter au plus profond du silence, par l’après-midi d’un faune, dans la lumière courbe du jour, le décillement des yeux, pour lire en son secret, le chemin de lumière, ici prométhéen, là végétal, animal, toujours paysage… ne fallait-il pas alors aller à la rencontre du mystère, rendez-vous bien particulier pour voir, accéder, photographier ces présences qui ont grandi dans l’ombre épaisse et sous la terre, pour pouvoir en vivre instinctivement, la susceptibilité ordonnée et connaissable dans une reconnaissance mutuelle… l’établir par une autre photographie, sans doute en noir et blanc, afin que sourde ce que Rimbaud dit du jardin qui soudain s’illune, la présence poétique de la pierre en sa mystérieuse raison, en son magnétisme, dans sa magnitude. Il est des entreprises difficiles, quasi prométhéennes, qui sont aussi les forges du futur, la découverte des pôles.

Un voyage s’était fait entre la Géode de Pulpi, en Andalousie, dans la découverte de l’énergie apaisante, magnétique des cristaux de sérénité, prélevés dans la grotte aux parois translucides et les silex affleurant dans le jardin de sa maison à la campagne, voyages au centre d’une terre dont les portes avaient été franchies au Groenland, six années plus tôt, comme si Juliette avait établi avec ce monde silencieux et précieux des pierres, un voyage initiatique, chamanique dont l’ample mouvement vernien s’accomplissait dans un don, celui de d’une moisson bien étrange, une récolte des silex en son jardin comme un sel qui vient et qui affleure… Il y a dans cette aventure ce que la terre porte à la fois de ces rêveries de la volonté et de celles du repos, l’ombre portée de Jules Verne, un processus quasi magique digne du roman.
Cependant une grande frustration m’a étreint, sorti des lectures des pierres de Caillois, étais-je bien dans ce même enchantement à la présentation des photographies de Juliette…ou n’était-ce qu’un rendez-vous manqué, était-il aussi question pour Juliette d’approcher la capacité des pierres à générer des images, à s’épanouir en un processus anagogique, (élévation du point de vue, de l’âme vers les choses célestes) dans une forme de transfert aimable, reliant le processus du Vivant à tout un imaginaire, actif et pertinent, à un ordre secret du Monde, à une architecture où se répondent microcosme et macrocosme.


Sur le plan de l’intention, on ne pourrait en douter, sur le plan de la réalisation, le résultat semble beaucoup plus problématique; c’est sans doute ce que Marta Ponsa évoque dans son texte de présentation, cette incapacité humaine de percer les secrets qui sont cachés dans la pierre, alors qu’il est question aussi des forces mystiques et alchimiques contenues dans la matière. La seule présentation des pierres dans le dispositif de la photographe était-il en capacité d’approcher ce mysterium, ces mysteria, ces vérités supérieures révélées à la raison ou son propos était-il seulement de nous mettre en présence de celui-ci, via la photographie?
La Susceptibilité des Roches par Juliette Agnel… Dix sept photographies sur fond bleu semblent témoigner d’une difficulté à percevoir ces pierres photographiées devenues silencieuses, sans plus d’invisibilité active comme si un constat avait figé leur pouvoir d’émettre cette beauté particulière qui anime en profondeur leur mystère et les rend au delà de leur état actuel, témoin d’un travail qui remonte à la Création, au Cosmos, et, suprême conscience, dont elles sont parts actives et symboliques.
Les Pierres n’ont cessé d’enchanter les hommes depuis l’aube de l’humanité, c’est donc qu’elles ont ce pouvoir secret que Roger Caillois a distingué par ses textes littéraires et poétiques, en donnant une sensibilité élective, à travers un regard éluardien, assez universel à leur présence indéfectible , il écrit dans la préface de Pierres ed. nrf, poésie/Gallimard « je parle des pierres: algèbre, vertige et ordre, des pierres, hymnes et quinconces, des pierres dard et corolles, orée du songe, ferment et image.... »

Juliette Agnel la susceptibilité des roches. ÉCOLE DES ARTS JOAILLERS PARIS.
Ici, sur fond bleu, les pierres reposent dans cette photographie quasi objective, dans une uniformité de taille, (visiblement les différences , de taille et de poids, qui sont ce que la pierre est, ne sont pas prises en compte par la photographie) de lumière globale, sans qu’aucune lecture de l’identité de chacune ne soit a minima le lieu d’une approche singulière et poétique dans une lecture joyeuse, précise, enchantée, vibrante et vivante.
Pour ma part je n’ai pas vraiment compris pourquoi ce traitement uniformisant avait été nécessaire à l’expression de la photographe, étant peu habile à noter chaque correspondance éventuelle, à chaque interprétation possible, du rêve majeur afin que quelque chose du mystère, du vivant (tiens! alétheia…) puisse se dévoiler, se poétiser, en naître et que la photographie en soit dialectisée, que la photographe en soit plus éclairée, récipiendaire inspirée et active, face à l’Infini, l’Immémorial.
Et pourtant…! comment ne pas repenser à ses travaux précédents, à ce voyage dans la grotte d’Arcy sur Cure, aux étoiles, le poids de la terre, ?
je cite mon propos issu d’un article écrit à cette occasion: « je parle ici des arbres qui sont avec le ciel étoilé, les ferments de l’expérience photographique de Juliette Agnel. C’est en ces images, déjà périphériques, rapides, puis lentes, à la recherche des secrets de la nuit, de la nuit éveillée, de ce qui s’est dérobé au regard diurne pour apparaître sous ce jour différent, dans ce repos, cet abandon, ce sommeil, mais à la manière des surréalistes, le regard vivant, les yeux fertiles. »
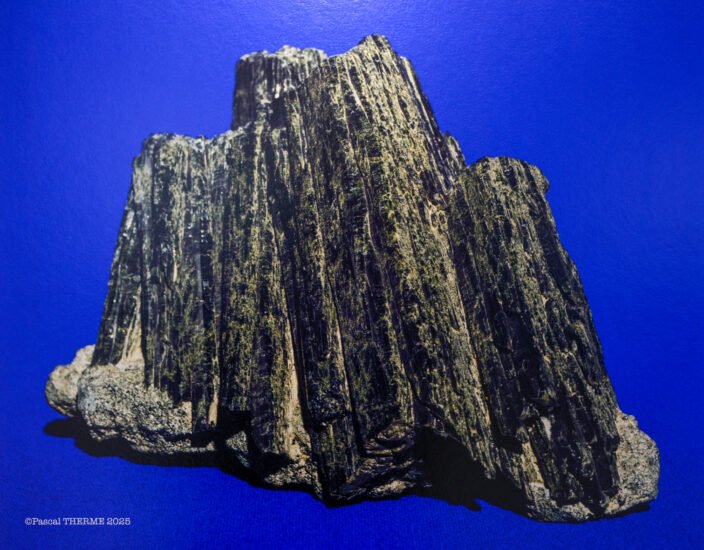
La Susceptibilité des Roches, Juliette Agnel
On se souvient de la nuit talismanique des pharaons noirs, issue du Soudan, de ces pyramides à l’éternité sage, qui faisait le rêve déjà des romantiques, de ces Orients Nervaliens, présences de la nuit au fond des nuits, voyageant giboyeuses dans une sorte de rapport aimanté, quand le texte échappe, que l’image accorde …. ce, en quoi, tout se succède et s’ensuit dans le travail photographique de cet esprit qui va à l’enchantement. Tout alors songe à indexer aux étoiles ce poids de la Terre, comme un conte philosophique accordant l’expérience du monde au repos aigu de la nuit…et à ses chants, reliance des images qui en naissent, certitude, incertitude de ce qui fuit et révèle…adoubements d’aubes… »
Une continuité existe t -elle entre ce livre l’invisible et la présente exposition, j’écrivais à l’époque: « N’y a t-il pas chez Juliette ce désir de tutoyer l’infini, de dialoguer avec ces puissances augurales, pour pousser la porte de ce Sacré dont parle étrangement les Monts d’Arrée traversés de ces forces telluriques, cosmiques qui les ont préservés jusqu’à maintenant ?
Était-il question de servir ce rêve minéralogique, issu du romantisme allemand, Novalis, Schiller, caressé par Breton, encore mobile en ces temps de fureur et si présent dans les âmes des artistes, des poètes cherchants, au souffle marmoréen, dont cette exposition est aussi le témoignage….
….et plus qu’on ne serait tenu de le penser quand on retrouve dans cette définition des qualités précises qui font l’amant éprouvé; l’ amant de la nature, défini ici, en ces disciples à Saïs, pour faire unanimité, Novalis écrit « Un long et infatigable commerce, une libre et sage contemplation, l’attention portée aux moindres signes et aux moindres indices, une vie interne de poète, des sens exercés, une âme pieuse et simple, voilà les choses essentiellement reprises du véritable amant de la Nature, et sans lesquelles nul ne verra prospérer son désir. » Les Disciples à Saïs.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.
L’AVENTURE DE PAOLO VENTURA, PROMENADE DE NUIT, carte blanche de Photo Days.
Depuis 2020, Photo Days organise avec la Fondation des Artistes des expositions photographiques au sein de la Rotonde Balzac, un lieu chargé d’histoire situé dans les jardins de l’Hôtel Salomon de Rothschild. Après rénovations au gout d’un orientalisme séduisant la Rotonde Balzac, accueille cette exposition dans une intimité et une proximité charmante. Ré-édité chaque année Photo Days programme un artiste en ce lieu, ici, Paolo Ventura expose une petite série d’images entre négatif et positif noir et blanc faisant dialoguer » fiction, mémoire et architecture, dans une mise en scène délicatement fantastique. » DP
Plus d’informations : www.fondationdesartistes.fr
Présentation du travail de Paolo Ventura et propos de l’artiste suite à cette présentation in Vivo par Alain Sayag, à la rotonde Balzac.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.
On pourrait également commenter ce qui anime le processus de production, réalisé avec un smart phone, de jour à travers une déambulation, à la lecture de ce Paris haussmanien, ce Paris de Baudelaire et de Balzac, des salons littéraires, cadre historique de ce XIX ème siècle si riche, si bruissant de cette fureur romantique des Happy Fiew, à l’élégance tangible, au succès redoutable, revenus, ici, en fantôme, dans un pratique innovante et scripturale.
En effet Paolo Ventura refonde un négatif sur cuivre à partir du fichier numérique, retravaille le ciel en le masquant de noir, retire l’activité diurne de la ville, passants, voitures, tout élément de ce présent envahissant et déchu, pour entrer dans une vision plus théâtralisée, plus conceptuelle, plus objectivée, plus architecturale, faisant des grands bâtiments la toile de fond d’un lieu entre Jour et nuit, entre deux mondes, deux réalités, idéalement entre négatif et positif par la valeur de ses gris, se signalant avant tout comme un artefact idéal de la ville Lumière, épurée, tirée à quatre épingles par ses lignes de force, disponible à tout fantasme, à tout film même, qui puisse se superposer au constat de la réalité quotidienne. Il faut visiblement à Paolo la réverbération de son nom dans l’Aventure reste toujours en devenir idéalement, même quand elle s’est formalisée dans un projet abouti et reclassé comme un chapitre d’une vie qui s’écrit à travers l’Art et ses productions. On croiserait volontiers Beckett ou Barthes, Calaferte ou Modiano, dans ce décor idéal propre à s’acquitter de toute invitation intéressante, profilant dans cette échéance le faux col d’une ville monde échue aux artistes et aux joies d’une société qui est avant tout s’est mise à paraître à force de désirs et d’applications.
Ces tirages, épreuves ont la force des objets chinés au fil des jours, chez l’antiquaire, comme s’il s’agissait d’un aventure littéraire rapportée ici grâce aux vues issues d’un lointain passé, modernes pour autant et qui seraient ré-apparues, suite à la succession de différentes périodes de disparition, aux yeux de l’écrivain, dans une succession de situations et d’aventures issues soit du Nouveau Roman à la Robbe-Grillet, soit du roman policier ou encore de ces planches de Tardi sur ce Paris échu, mais persistant, comme la possibilité de leur appartenance à la succession d’une personnalité à la Breton, dans une vision où l’artiste est déjà ce personnage de roman qui accompagne cette photographie dans ce prisme du temps, qui joue avec sa matérialité.

Photo-days 2025-Paolo Ventura, Rotonde Maison Balzac, Paris.
Cette plasticité des épreuves photographiques m’évoque une sorte de somnambulisme actif, de rêve éveillé très sur-réalisant, dans une mantique de conteur, statut d’un Jeu romanesque et romancé, dont la fusion avec ces épreuves, à la technique mixte, enfouit et rénove ce Paris perdu, comme s’il s’agissait d’un décor, d’un film étrange, comme pris à cette épissure du temps fictif de sa déambulation, de sa promenade de nuit, de ses différentes époques mais dans son architecture, comme si l’architecture avait ce pouvoir d’un rêve où tout le vécu de la ville au XIX ème se soit concentré, glissé invisiblement dans les pierres et qu’à leur simple évocation après que ce travail de plasticien ait eu lieu, Paolo Ventura pouvait en solliciter le souvenir précis et voyager au sein de ces substances, rêve incroyable et profond. Paris, ville monde au centre du Temps et Paolo Ventura, artisto, poète visionnaire en son alchimique travail de résonances magnétiques…et singulières.
On s’attendrait à une sorte de formule magique, un Sésame ouvre toi qui évoque, voire plus, ces dimensions parallèles où le roman, l’histoire appelle ce marcheur en ces déambulations, inversants le cours du jour en nuit claire, à la netteté optique redoutable, comme une preuve de l’extra lucidité du voyant ou de celui, qui, à l’entrée des foires se faisait passer pour tel…dans ce jeu de querelles entre la fiction, le théâtre, la photographie, et ce Paris qui ne cesse de jouer à cache cache avec son statut de héros et de personnage central, toujours énigmatique, propre à recevoir de toute époque leurs légendes et leurs romans.
Pascal Therme, le 11/11/2025
Les contrastes de Photo Days 2025
10.11.2025 à 18:33
Victoria Ruiz et ses photographies vibrantes, à la convergence de la spiritualité, la nature et la performance
L'Autre Quotidien

Texte intégral (1948 mots)
« Pour moi, les costumes ont toujours fait partie intégrante de tout », explique Victoria Ruiz, photographe et artiste multidisciplinaire. « Culturellement, j'ai grandi au Venezuela en considérant les costumes non pas comme quelque chose de distinct de la vie quotidienne, mais comme quelque chose qui y est profondément ancré, en particulier à travers le prisme du carnaval. Le carnaval est dans notre sang. Ce n'est pas seulement une fête, c'est une façon d'exprimer l'histoire, la résistance, la joie et le chagrin. En fin de compte, un costume est quelque chose que l'on porte et qui raconte une histoire. »

© Victoria Ruiz, shared with permission
À travers des images saisissantes et saturées, Ruiz exprime sa fascination pour la nature, la danse, la spiritualité et la religion africaine diasporique. Citant les systèmes de croyances des Amériques tels que la Santería-Ifá, le Candomblé, l'Umbanda et l'Espiritismo, l'artiste explore l'histoire et la résonance culturelle de la religion en tant que modes de résistance et d'adaptation. Ces croyances mélangent souvent « les traditions spirituelles africaines avec des influences indigènes et coloniales », explique-t-elle dans un communiqué.
Actuellement basée à Londres, Ruiz s'inspire de ses expériences d'enfance à Caracas, la capitale du Venezuela, où elle et sa famille ont été confrontées à la fois à des pratiques ancestrales nuancées et à une violence politique urgente. « J'ai grandi entourée de personnages, certains issus de traditions folkloriques, d'autres de scènes plus troublantes comme la répression militaire ou policière », raconte l'artiste à Colossal. Elle poursuit :
J'ai très tôt compris que les uniformes étaient aussi des costumes. Ce que les gens portaient pendant ces moments de violence ou de protestation créait des symboles puissants. C'était une sorte de carnaval sombre. Et je suis devenue très curieuse de savoir ce que ces vêtements signifiaient et comment ils pouvaient inspirer la peur, le pouvoir ou la solidarité.

© Victoria Ruiz, shared with permission
La musique et la performance sont au cœur du travail de Ruiz. Depuis son plus jeune âge, elle a étudié le ballet, le flamenco et la danse contemporaine, mais ce n'est qu'après avoir déménagé à Londres et commencé à collaborer avec des danseurs que les éléments de sa pratique ont vraiment commencé à prendre forme. « Les voir incarner les costumes, les animer par leurs mouvements et leurs intentions, a transformé toute ma pratique », explique-t-elle. « C'est devenu un moyen de donner vie aux pièces et de créer une narration immersive et émotionnelle. »

© Victoria Ruiz, shared with permission
Ruiz travaille avec toute une gamme de tissus et de matériaux, tels que des fleurs artificielles et d'autres accessoires, en fonction du thème de la série. Elle réutilise souvent les costumes afin de mettre l'accent sur la durabilité. « Chaque costume et chaque image sont une porte vers le divin ; c'est une offrande visuelle, une invocation spirituelle », explique Ruiz. « Ce sont mes propres interprétations de la façon dont ces forces m'ont façonnée et protégée. Je suis toujours dans ce voyage, et ce travail est une sorte de gratitude, une lettre d'amour à ces pouvoirs invisibles qui m'ont portée. »
L'artiste travaille actuellement sur une série de masques de protection, s'inspirant de l'ingéniosité des masques faits à la main utilisés lors des manifestations auxquelles Ruiz a assisté lorsqu'elle vivait à Caracas. « À un moment donné, les masques à gaz ont été interdits d'entrée dans le pays, alors les gens ont réagi avec créativité et instinct de survie en créant des masques à partir de bouteilles d'eau, de carton, voire d'animaux en peluche », explique-t-elle. « J'ai trouvé cela très puissant : cette créativité face au danger, ce besoin de résister et de survivre en créant. »
Pour en savoir plus, consultez le site web et le compte Instagram de l'artiste.
Rémy Martin, le 11/11:2025 avec Colossal
Les photographies vibrantes de Victoria Ruiz

© Victoria Ruiz, shared with permission
- GÉNÉRALISTES
- Basta
- Blast
- L'Autre Quotidien
- Alternatives Eco.
- Le Canard Enchaîné
- La Croix
- Le Figaro
- France 24
- France-Culture
- FTVI
- HuffPost
- L'Humanité
- LCP / Public Senat
- Le Media
- Le Monde
- Libération
- Mediapart
- La Tribune
- EUROPE ‧ RUSSIE
- Courrier Europe Centrale
- Desk-Russie
- Euractiv
- Euronews
- Toute l'Europe
- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient
- Haaretz
- Info Asie
- Inkyfada
- Jeune Afrique
- Kurdistan au féminin
- L'Orient - Le Jour
- Orient XXI
- Rojava I.C
- INTERNATIONAL
- CADTM
- Courrier International
- Equaltimes
- Global Voices
- I.R.I.S
- The New-York Times
- OSINT ‧ INVESTIGATION
- OFF Investigation
- OpenFacto°
- Bellingcat
- Disclose
- Global.Inv.Journalism
- MÉDIAS D'OPINION
- AOC
- Au Poste
- Cause Commune
- CrimethInc.
- Hors-Serie
- L'Insoumission
- Là-bas si j'y suis
- Les Jours
- LVSL
- Médias Libres
- Politis
- Quartier Général
- Rapports de force
- Reflets
- Reseau Bastille
- Rézo
- StreetPress
- OBSERVATOIRES
- Armements
- Acrimed
- Catastrophes naturelles
- Conspis
- Culture
- Curation IA
- Extrême-droite
- Human Rights Watch
- Inégalités
- Information
- Internet actu ✝
- Justice fiscale
- Liberté de création
- Multinationales
- Situationnisme
- Sondages
- Street-Médics
- Routes de la Soie
